| |
 |
|
|
Certains pourtant,
à l’heure de sa sortie en salle (il n’est jamais trop
tard…), ne s’y sont pas trompés. Ainsi, Hélène
Frappat des Cahiers du Cinéma, remarquait dans
le numéro de septembre (1), " Dès
l’instant où le récit familial et la description
d’une communauté cèdent brutalement la place
au déroulement monotone, monocorde d’une captivité
mutique, Le Pianiste bascule dans Le Locataire ".
Dans ces deux films en effet, peu d’évènements
mais l’émergence d’une folie singulière, d’un
regard, d’une subjectivité. Films considérés
comme autant d’exorcismes et, non sans toucher à nos
peurs les plus primaires ; de celles dont a su si bien
faire son lit, la subliminale et antique série La
4ème dimension. Que l’on songe à
cette scène, où Szpilman, seul rescapé,
titube au milieu du ghetto fantôme : à cet
instant précis, sur quoi pleure t-il ? Sur l’effroyable
destin des siens ou sur le sien propre ? Prêt qu’il
est déjà, malgré tout, à sauver
sa peau et de la façon la moins héroïque
qu’y soit… Dès lors, adieux hauts sentiments, le voilà
qui erre, rase les murs, se terre, planqué derrière
une fenêtre, se contentant de regarder le combat des
siens, ne voulant plus rien en savoir… Pas de héros,
nulle identification possible.
Polanski ne nous laisse plus rien à quoi nous raccrocher,
en prise avec rien. D’où notre trépignement,
ce malaise diffus et croissant devant l’attente résignée
- la " lâcheté " ( ?!)
de Szpilman; presque soulagés que nous sommes d’entendre
le bruit de chars… Qu’il se passe enfin, quelque chose !
Exit donc, " le folklore " et quoiqu’en
disent certains, les " scènes à faire ".
Le Pianiste creuse le sillon de la vacuité,
de l’absence, du rien.
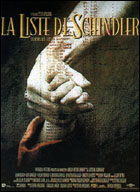 |
|
|
|
C’est en ce point
même, ce trou autour duquel tourne Le pianiste,
que réside l’insupportable. Polanski atteignant par-là,
un dérangement qui vaut dans un genre nouveau, celui
de ses précédents films et, en quoi il
se distingue de La Liste de Schindler (Spielberg),
La vie est belle (Benigni) et autres films sur le sujet.
Ici en effet, nul artifice, nulle reconstitution, Polanski
s’en tient à son personnage, ne le lâche pas.
En place d’une interprétation, contre toute explication,
là où d’autres ont collé des images,
Polanski laisse un trou ; trou dans le temps qui restera
sans réponse. Par exemple, lorsque son frère
et sa jeune sœur seront séparés du reste de
la famille, on imagine alors le pire, les secondes s’égrènent,
on n’espère plus… Et, les voilà qui ré
apparaissent, on ne sait d’où – " Pourquoi ? "
interroge Szpilman-. Comme on ne saura ce qu’il adviendra
d’eux, après leur embarcation dans ces convois dont
nul ne pouvait prédire la destination; on parlait alors,
d’ " extermination ". La réalité/vérité
sera encore toute autre...
Polanski s’en tient à un regard - un regard extérieur
-, évitant cet écueil : donner forme à
ce qui est au-delà de toutes images, de ce
qui a été voulu, précise Wacjman
dans son article " L’art, la psychanalyse et le
siècle ", sans images (…)
p35 : la grande industrie nazie n’a pas produit des charniers,
mais des cendres, rien de visible. Elle fabriquait de l’absence.
Irreprésentable ". La question étant
alors : " comment montrer ce qui
excède toute image (…) comment faire œuvre sans transposition,
ni oubli ? "
| |
 |
|
|
Polanski y répond
de cette place du " s’il n’en reste qu’un qui témoigne ".
On retiendra à cet égard, une des dernières
scènes du film (pour moi, la dernière) dans
laquelle, Szpilman et un ami cherchent en vain, les traces
d’un ancien camp : " J’étais pourtant
sur que c’était par ici…" dira l’ami; au lieu
dit, une prairie verte s’étendant à perte de
vue. Plus rien…
Dès lors, taxer Le Pianiste d’académique,
n’est ce de l’ordre de la " défense "
-dixit Freud?….A chacun d’y aller de ses interprétations !
Ou …Dès lors, taxer Le Pianiste d’académique,
ne relève t-il pas de " mécanismes
défensifs " - dixit Freud - ?… A chacun
d’y aller de ses interprétations !
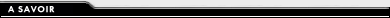 |
|
Sources
1) Cahiers du cinéma n°571
2) Cahiers du cinéma n°548
3) Cf Lacan, l’écrit, l’image
|
|
|
