 |
|
|
|
Le monde post-11 septembre pédale dans la
semoule, tente de comprendre s’il est un Al Quaida en puissance
ou bien deux tours jumelles en voie de déliquescence accrue.
Il réfléchit le monde. Mais dans le cyber espace, personne
ne l’entend crier. Hurler la mort. Panser les plaies en filmant,
en se filmant puisque les pères ne le font pas, toujours préoccupés
à ne pas assumer et, accessoirement, à envoyer leurs pitoyables
productions camescopées à « Vidéo Gag ». Le phénomène
n’est pourtant pas flambant neuf. Michael Moore, figure de
proue du docu mainstream, a fourni les bases avec Roger
and me et The Big one. Chez nous, c’est Cabrera,
Dieutre et Libsitz qui, entre autres essayistes, ont récemment
récupéré le bébé. Et, bonne nouvelle, il en va du film documentaire
comme du rock. On s’est fait cette réflexion ces derniers
jours, en découvrant le tumultueux Histoire d’un secret
et l’archi conceptuel No pasaran. Ces deux ogives dégoupillées
ne sont pas sans évoquer les meilleurs écrits érudit-rock.
Tout, d’images trouvées au hasard de personnelles recherches
pour Henri-François Imbert jusqu’au mystère insondable, bien
à point pour Mariana Otéro, absolument tout évoque les meilleurs
témoignages rock. De Nick Kent et son obsession du Beach boy
Brian Wilson qu’il suivra pendant trente ans à Lester Bangs
et sa juvénile fascination pour les Count Five, tous les éléments
romantico-journalistiques sont là. Cerise sur le gâteau bien
copieux de la généalogie du secret, l’axiome de Philippon
qui veut que le cinéma commence là où il y a des histoires
de fantômes dans les caves, des monstres sous le lit, là où
en somme il y a de l’enfance.
| |
 |
|
|
Et c’est adéquatement que la réalisatrice
d’Histoire d’un secret remonte au point de départ,
cherche à mettre la main sur les fantômes et autres monstres
qui lui empoisonnent l’existence. De quoi sa mère est-elle
morte ? Sonder la moindre parcelle de propriété privée
familiale, astiquer le moindre souvenir, presser comme des
citrons parents et amis. Bref, foutre doucement la merde.
Courser les réponses, traquer les non-dits. Il y a dans ce
monde fâcheux suffisamment d’occasions d’en souligner la vacuité
pour, entre deux dépits, reconnaître honnêtement un travail
d’orfèvre, en l’occurrence celui d’Otero. Car la cinéaste
nous emmène là où le tant plébiscité Elephant de Van
Sant nous lâche. Dans la zone (frontalière) de l’explication,
du pourquoi du comment. Pourquoi ces deux gamins en sont-ils
arrivés là, bordel ? Dans ce monde pourtant si informé,
où les psys sont en passe de détrôner les Jésus, Allah et
Mahommet de tout crin, nous sommes en droit d’attendre des
éclaircissements. Fendre la glace de la virtualité, du doute.
Besoin de certitudes. Il est intellectuellement pertinent
de nous faire part d’hypothèses qui par ailleurs permettent
le désengagement, - très tendance ça le désengagement -, mais
il est tout aussi pertinent de spéculer sur des valeurs sûres.
De mettre sa parole en avant. En prendre le risque. Après
tout, on envoie bien des textos super subversifs, et signés
avec ça, à Fogiel. On aimerait que Van Sant nous dise :
« Ces deux ados ont tué parce que ». Et c’est
bien connu : comme l’a dit l’historien Pierre Legendre
en 2000 : « L’image ne garantit rien, tout est
affaire de montage ». Raison de plus pour dire, tirer
des plans sur la comète. Ami(e)s documentaristes, continuez
donc de nous mentir. On vous Depardonne.
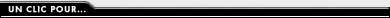 |
|
|
