| |
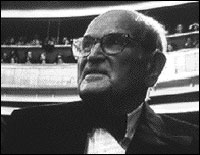 |
|
|
En 1975, à l’initiative de Georges
Cravenne, l’Académie des Arts et Techniques du cinéma est
fondée. Afin de donner un équivalent français aux Oscar,
les César sont créés et ont pour ambition de distinguer
les œuvres cinématographiques « les plus remarquables »
sorties durant l’année. Les premières éditions récompensent
généralement des œuvres de bonne qualité mais célébrant
des artistes déjà reconnus dans la profession et par la
critique. Puis, au fil des éditions, il devient de plus
en plus aisé de faire des pronostics tant les précédents
lauréats ne représentent qu’un seul et unique pan du cinéma
français, celui que Cravenne s’attache à appeler la « grande
famille ». Aujourd’hui, une production de Claude Berri
mise en musique par Philippe Sarde et dont la majeure partie
des comédiens a pour agent Dominique Beshneard, à toutes
les chances de rafler un certain nombre de statuettes. A
contrario, quantités d’auteurs passionnants sont bannis
des éditions sous prétexte de refuser ce rassemblement soi-disant
fédérateur, ou tout simplement par rejet des conventions
méritocratiques. Du coup, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard,
Jacques Rivette ou encore Eric Rohmer, pour les plus connus
d’entre eux, n’ont jamais reçu la moindre distinction et
certains n’ont pu tenter leur chance qu’à coup d’académisme
forcené qui caractérise si bien cette « qualité française »
ici défendue : Le Dernier métro de François
Truffaut, Les Destinées sentimentales d’Olivier Assayas
ou plus récemment, Les Sentiments de Noémie Lvovsky
restent les meilleurs exemples de ce que les César offrent
comme limites. Mais cette absence symptomatique d’ouverture
sur la diversité de la création est aussi une question d’image
car il faut avant tout rester en adéquation avec les goûts
du grand public pour rester crédible. On va préférer honorer
Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain plutôt que Anatomie
de l’enfer ou applaudir à tout va André Dussolier et
non pas Guillaume Depardieu.
