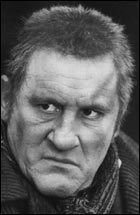 |
|
|
|
En près de trente ans, on voit et
revoit toujours les mêmes postulants, à croire que le cinéma
français manque furieusement de prétendants. Pour le record
des nominations, on regardera du côté de Gérard Depardieu
(13), Isabelle Huppert (13), Michel Serrault (12), Daniel
Auteuil (9 en quinze ans) ou encore Bertrand Tavernier (8),
André Téchiné (7), Patrice Leconte (7). L’une des catégories
capables de représenter au mieux ce vide béant sur lequel
repose ce principe de récompenses est très certainement
celle du « meilleur espoir », censée encourager
un acteur ou une actrice aux débuts prometteurs. Elsa Zylberstein
est nommée trois ans de suite sans jamais rien recevoir
(à croire que les espoirs sont retombés), Isabelle Carré
en 1992 puis en 1998 (une revenante très certainement) et
plus drôle, Emilie Dequenne en 2003 pour Une femme de
ménage alors qu’elle recevait le prix d’interprétation
féminine à Cannes quatre ans plus tôt. Prise de risques
minimes. Du côté des réalisations, on favorise indéniablement
les reconstitutions historiques à budget faramineux (Cyrano
de Bergerac, Le Dernier métro, Tous les matins
du monde, Le Pianiste) ou encore les films clichés
un brin démago mais qui ont su séduire le public (Amélie
Poulain, Le Goût des autres).
| |
 |
|
|
Malheureusement, le cru 2004 n’échappe
en rien à cette règle. Julie Depardieu concourt naturellement
pour le meilleur espoir féminin tandis que les catégories
les plus prestigieuses voient se côtoyer Denis Arcand pour
Les Invasions barbares, l’habitué Jean-Paul Rappeneau
avec Bon voyage (qui ressort pour l’occasion en salle),
et, nouvelle venue, Noémie Lvovsky qui, pour ce faire, a
mis de côté toute l’originalité de La Vie ne me fait
pas peur pour se laisser produire par… Claude Berri.
Au final, le palmarès est à la hauteur de nos espérances :
Les Invasions barbares, par ailleurs canadien, est
consacré meilleur film et meilleure réalisation sachant
que ce semblant de film ignore complètement la mise en scène,
trop narcissique et suffisant pour concevoir l’idée même
du hors champ. Côté technique, on donne la pièce à Bon
voyage pour ses efforts de « qualité française »,
et Omar Sharif reçoit le César du meilleur acteur pour servir
l’image de tolérance (consensuelle) que l’Académie s’attache
depuis toujours à défendre. Seul réconfort, Depuis qu’Otar
est parti de Julie Bertucelli a reçu le titre de « meilleure
première œuvre ». Mais qu’en est-il de Tiresia,
Pas de repos pour les braves, Histoire de Marie
et Julien, Un film parlé, etc… ? Qui ira
redécouvrir ces joyaux pour lesquels il est bon de croire
encore à l’exception culturelle justement défendue par Agnès
Jaoui lors de la soirée ?
Rendez-vous l’année prochaine dans l’espoir d’une consécration
bien méritée de L’Esquive. Ne rêvons pas.
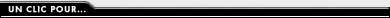 |
|
