Les comportementalistes tentent de démontrer
que nos gestes nous trahissent. On pourrait aussi s’intéresser
à ce que les mouvements de caméra dénoncent.
Article fondateur à plus d’un titre, De l’abjection,
écrit par Jacques Rivette et paru en juin 1961 dans les Cahiers
du cinéma, dénonçait avec virulence Gillo Pontecorvo et
plus encore l’un des travellings de son film Kapo.
Exemple fameux de mise en scène dénoncée, on pouvait y lire :
« L’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling
avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant
soin d’inscrire exactement la main levée dans un angle de
son cadrage final, cet homme n’a droit qu’au plus profond
mépris. » Il s’agissait en l’occurrence de recadrer
le corps sans vie d’une prisonnière accrochée aux fils de
fer barbelés d’un camp de concentration allemand. Ces quelques
lignes, pour négligeables qu’elles puissent paraître, eurent
sur la cinéphilie et la critique française une influence considérable.
Elles venaient de lier inextricablement le cinéma et la morale,
l’éthique et le style, la mise en scène et la dignité. Rivette
avait trop de foi en l’image pour permettre qu’on fît du beau
avec la mort. Jean-Luc Godard ne dirait pas autre chose en
affirmant que le travelling est « affaire de morale. »
| |
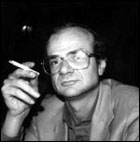 |
|
|
Le critique Serge Daney fit par la suite
de cet article un des piliers conceptuels de sa grille d’analyse,
rédigeant des textes sur cette figure maudite qui devint dès
lors ce mot de passe pour cinéphiles : « le travelling
de Kapo ».
D’aucuns considèrent aujourd’hui que le cinéma et la morale
n’ont plus rien à faire ensemble. La foi dans les images s’est
beaucoup émoussée et celles-ci prennent désormais de grandes
libertés avec le monde, que jadis elles capturaient, qu’à
présent elles inventent. On peut aussi réhabiliter Pontecorvo
et interpréter différemment son fameux travelling (L’analyse
de séquences, Jullier, p142). Toujours est-il que certains
mouvements de caméra me semblent encore à présent abjects
et méprisables.
On sait l’industrie de la Télé-psy en général et du talk-show
testimonial en particulier, florissante. Cette entreprise
consiste à récolter les témoignages de « vrais gens »
(à opposer aux élites médiatisées, uniques et véritables seigneurs
de la société spectaculaire), dans le but de produire de l’image,
du son, de l’émotion, en un mot, du spectacle. De Vis ma
vie à Y’a que la vérité qui compte en passant par
ça se discute, ces programmes abondent et les méthodes
varient, plus ou moins contestables, mais ce Barnum du vécu
reste prospère. Dans l’ensemble, le péquin fait recette, les
coûts minimes (le témoignage vécu est une denrée gratuite)
permettant des profits conséquents.
Mais ce qui nous intéresse ici n’est pas le principe de ces
émissions, c’est l’ignominie de certaines mises en scène.
|
