|
L’un des buts avérés de ces programmes est
la recherche effrénée d’émotion. Aussi n’est-il pas rare de
voir un invité témoin verser une larme, ou s’il veut bien
être « bon client », éclater littéralement en sanglots.
Et c’est à ce moment que se produit le geste infect :
le réalisateur zoome !
Il se précipite de tout son objectif pour capter le visage
défait du malheureux témoin consentant. Sous l’effet double
de la remémoration et de l’exposition médiatique, celui-ci
vient de craquer, aidé peut-être en cela par un animateur
surjouant l’empathie tandis qu’il soulignait l’aspect effectivement
dramatique du témoignage. En somme, le dispositif télévisuel
se charge de tirer les larmes, le zoom parfait ce mouvement
et vient littéralement les arracher. Reste pour le public
à se repaître, à satisfaire sa pulsion scopique.
| |
 |
|
|
Le travelling de Kapo semble bien innocent
en comparaison de ce zoom des talk-show. Parce que tout d’abord,
le zoom, contrairement au travelling, est par essence une
figure stylistique discutable. Zoomer revient à percevoir
un surplus d’information, à dépasser les facultés humaines,
voir plus sans avoir à se déplacer. C’est donc un mouvement
paresseux, qui contrairement au travelling n’exige pas qu’on
change de point de vue. C’est un geste immobile et voyeur,
masturbatoire on dit certains, lâche, qui veut plus et mieux
sans effort, sans risque, sans avoir à toucher du doigt ce
qui est donné à voir. C’est un geste pauvre et inhumain, glacial
et pervers, que la plupart des réalisateurs évitent, si ce
n’est pour exprimer quelque chose de précis (voir les zooms
associés au personnage de Dany dans Shining et qui
symbolisent ses facultés médiumniques, son don de voir plus
et mieux que le commun des mortels).
Sans doute le comportement du Nord vis-à-vis du Sud est-il
une sorte de zoom gigantesque. On regarde, on s’inquiète,
les infos défilent, on se lamente pour ces malheureux, la
guerre, la faim, les pandémies, on veut savoir, mais pas question
d’aller y fourrer son nez. Zoomer, c’est faire l’économie
de la proximité.
 |
|
|
|
Ensuite, si dans le film de Pontecorvo on
pouvait juger infâme un mouvement parce qu’il ne respectait
pas une mort fictionnelle, que penser d’une figure qui méprise
ainsi une personne réelle ? Les gens qui sont conviés
sur les plateaux de TV, obnubilés par l’illusion que produit
cette dernière (le poste est au centre de mon salon, de mes
soirées, donc occupe une position centrale dans mon existence
et les gens qui y œuvrent sont l’essieu de notre société),
se précipitent et donnent leur for intérieur en pâture à des
producteurs cyniques et à des spectateurs voraces. L’alibi
cathartique (cf. Lacan : « il y a des choses
qui vont sans dire et d’autres qui vont mieux en le disant »,
donc témoigner c’est se purger de ses maux) ou le prétexte
oiseux de l’édification des masses ne peuvent masquer longtemps
l’anthropophagie émotionnelle du dispositif télévisuel. Sans
respect, sans pudeur, sans égard, les zooms dépècent la viande
humaine, livrent les âmes et les corps au voyeurisme
rapace des spectateurs.
Serge Daney disait que le cinéma exige une attitude morale.
Car filmer c’est montrer, et montrer étant un acte, il implique
de fait une éthique. On peut penser que cette exigence morale
est plus forte encore concernant la télévision quand elle
se mêle de d’exposer des êtres réels et de diffuser leurs
histoires vécues. « Le zoom des talk-show » (terme
générique qui n’épuise pas le problème, ce genre de figures
ne se limitant pas aux dits talk-show et n’étant sans doute
pas systématiques dans le cadre de ceux-ci) est le signe indiscutable
d’une corruption des intentions, des protagonistes et des
fins du dispositif télévisuel. Aussi, un seul mot d’ordre :
Subvertir. On pourra par exemple se régaler des visites du
chanteur Arno qui prend toujours un malin plaisir à bousiller
le cadre des émissions où il sévit, ne répondant pas aux questions,
quittant le plateau quand il s’y ennuie, insultant l’animateur
s’il s’estime harcelé. Gageons qu’un zoom sur son visage ne
trouverait pour le recevoir qu’une grimace de défi.
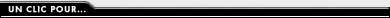 |
|
|
