SYNOPSIS :
Et si on parlait d'amour... dresse le portrait de personnes
qui parlent librement de leur sexualité : Résidant à Poix de
Picardie, un village dans la Somme, Bernard, un instituteur
à la retraite, et sa femme Violette, une aide-soignante, forment
un couple populaire dans la région qui n'hésite pas à pratiquer
l'échangisme et à organiser des soirées réputées "chaudes".
Cathy, une journaliste célibataire de Lyon, collectionne les
relations amoureuses de courte durée tout en rêvant d'une vie
de famille. Julien, commercial dans une start-up, et sa femme
Sophie, mère au foyer, s'avouent mutuellement leur infidélité.
Daniel et Karine sont pensionnaires dans un foyer de l'association
des paralysés de France, ce qui ne les empêche pas d'avoir une
vie sexuelle comparable à celle de couples normaux. |
|
....................................................................
|
ET VOUS, VOUS ÊTES
AU COURANT ?
| |
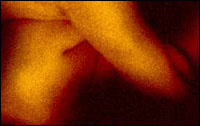 |
|
|
Le documentaire de Daniel
Karlin commence comme un reportage dans l’esprit de l’émission
"Strip-Tease" : nous suivons les pérégrinations
d’une famille dans une petite ville de province. Le mari se
présente aux élections municipales et cantonales,
la femme est aide-soignante… Mais le titre Et si on parlait
d’amour ne pouvait pas être pris au premier degré,
en tout cas, pas après les dix premières minutes
du film. Après tout, demande Karlin, c’est quoi l’amour ?
L’amour, il le prend par tous les bouts : l’amour, c’est
bien sûr les sentiments, mais ne dit-on pas également
" faire l’amour " ? Finalement, malgré
ce que l’on peut dire, y a t-il une différence entre
faire l’amour et baiser ? Karlin semble prendre la question
à l’envers, et créer une progression à
travers les quatre portraits qu’il dresse. L’amour, il n’en
parle pas tout de suite, ou plutôt, il fait mine de
ne pas en parler. Le sexe apparaît comme un cheveu sur
la soupe, dans tout ce qu’il peut avoir d’étrange,
d’ " anormal ". Aurions-nous pu imaginer
que le couple quinquagénaire provincial qui nous est
présenté est un adepte de l’échangisme
et des parties à plusieurs (on ne compte plus les corps…).
Loin d’être exposé comme une frivolité,
une vue de l’esprit, un comportement marginal mais discret,
une honte, la vie sexuelle de ce couple est montrée,
certes, mais tente d’être expliquée, en tous
cas d’être intégrée dans un quotidien,
des vies, un entourage qui n’est pas sans ignorer les pratiques
de leurs voisins, amis, fille ou grand-mère…
Ainsi commence une véritable
enquête d’investigation, dans laquelle Karlin, sans
jamais porter le moindre jugement, s’intègre en tant
que détective, posant des questions parfois naïves,
parfois simplement curieuses, dépassant souvent le
cadre sexuel pour aller plus loin. Pour chacune des personnes
présentées (car il ne s’agit définitivement
pas de personnages : leur vie sexuelle n’est pas un roman,
encore moins une fiction, malgré sa singularité),
Karlin retrace une vie, un parcours, un historique qui nous
permet de savoir (et de comprendre ?) quand et pourquoi
ont pu intervenir ces changements sexuels. Les réponses
sont aussi diverses qu’il y a des personnes interrogées.
Mais toutes se recoupent sur un point essentiel que l’on ne
soupçonnait pas : c’est une question d’amour.
Le sexe, on en use par amour ou par manque d’amour. Toujours
pour prouver quelque chose à l’autre, qu’on l’aime
ou que l’on soit aimé. Ainsi, si Violette a adopté
les pratiques sexuelles de son mari, c’est pour le garder,
pas tout de suite par goût. Si Cathy est une adepte
des partouzes, c’est dans l’acceptation d’un corps (par elle-même
et par les autres) qui était autrefois rejeté.
Au-delà de l’amour et du rapport à l’autre,
du sentiment, Karlin nous fait ressentir ce rapport à
soi que l’on ne peut ignorer, dans quelque rapport sexuel
que ce soit, et dans la vie en général. Le corps
semble s’offrir en sacrifice autant qu’il aspire celui de
l’autre. Le don de soi apparaît complexe. Ainsi, les
rapports extra-conjugaux peuvent dévoiler un réel
don à l’autre, à son mari ou à sa femme,
afin de contenter son désir.
|