|
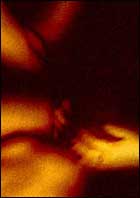 |
|
|
|
Au rapport au corps dans
l’intimité (même les partouzes sont une part
d’intimité : on ne baise pas avec n’importe qui,
Violette vous le dira mieux que personne, en témoignent
les listes de candidats, les sélections, les statistiques…)
vient s’accoupler le rapport à la caméra, la
mise en lumière d’un moment de nuit qui restait jusque
là caché, bien qu’il ne soit pas secret. Karlin
filme les corps qui s’entremêlent avec pudeur et respect
de l’autre, mais avec curiosité. Chacune des personnes,
chaque protagoniste ayant accepté de se laisser filmer
pendant l’acte sexuel, Karlin ne s’en prive pas, mais il le
fait avec un sens du respect associé à un certain
sens artistique : les corps dans la lumière tamisée
apparaissent bronzés, les sexes comme les visages sont
esquissés mais pas désignés, restant
dans le clair-obscur. On peut sentir dans ces séquences
le respect, car bien qu’ayant acceptés d’être
filmés, tous ne sont pas à l’aise de façon
égale avec la caméra et celui qui la tient.
Pas de voyeurisme donc, juste une certaine fascination, un
essai pour comprendre, mais aussi l’envie de tout dévoiler,
et d’en finir avec les préjugés qui disent sales
et anormaux les rapports sexuels singuliers. Car il ne s’agit
pas d’un film sur les parties à plusieurs, comme on
pourrait le croire après les deux premiers volets.
A des personnages " normaux "
à la sexualité particulière vient un
portrait qui semble donner tout son sens au titre du film,
celui de Daniel et Karine, tous deux paralysés des
membres inférieurs. Là aussi, nous sommes témoins
d’un récit qui nous présente les changements
advenus dans leur vie, mais à contre-courant des autres
couples présentés. Comment leur amour, plus
que leur handicap, les a amenés à avoir une
sexualité que l’on pourrait définir comme " normale ",
si l’on n’avait encore des idées préconçues.
" Normalité " et " anormalité "
apparaissent donc comme des notions toutes relatives, dans
un documentaire qui dévoile une véritable curiosité,
non seulement pour la sexualité, mais pour les hommes
et les femmes qu’il présente, au-delà de leurs
préférences sexuelles qui ne se limitent jamais
au sexe. Ainsi, Karlin élargit les frontières
du reportage, et nous nous souvenons peut-être plus
de certains passages que je qualifierai de "poétiques",
en particulier du portrait de Cathy et de son visage à
la fois dévoilant mais fermé, et de ses longues
marches en montagne. Les séquences de randonnées
apparaissent comme irréelles, loin du monde, un retour
sur soi, silencieux, le seul vrai coin de nature du film.
| |
 |
|
|
Ainsi, Karlin ne fait
pas que traiter un sujet que l’on aurait pu croire racoleur
et branché de façon sobre et intelligente, il
travaille également sur la notion de documentaire,
sur le rapport à son sujet et à ce(ux) qui l’entoure(nt),
à ce qu’il a envie de filmer, ce qu’il peut filmer,
traitant l’image avec autant de soin que le témoignage,
le discours. Il interroge également le rôle du
cinéaste, qui est ici le reporter : quelle doit
être sa place ? Comment peut-il intervenir ?
Karlin n’hésite pas à faire entendre sa voix,
mais ne dévoilera jamais son visage, entrant dans l’intimité
de ses sujets, mais restant à bonne distance du spectateur,
limitant ainsi son pouvoir sur le documentaire qui ne devient
jamais fiction, qu’il habite pourtant de sa voix de stentor :
pas de commentaire de sa part, juste des questions parfois
naïves, parfois guidantes voire perverses, psychologisantes
un peu, peut-être parfois un peu trop, faisant mine
de s’éloigner du sujet pour toujours y revenir. Il
instaure ainsi une dimension humaine, un rapport vrai avec
les personnes filmées, tout en leur laissant une vraie
liberté, leur intimité, malgré tout.
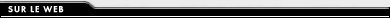 |
|
|
 |
|
Titre : Et si
on parlait d’amour…
Réalisateur :
Daniel Karlin
Directeur de la photographie
: Michel Bonne
Image : Michel
Bonne
Son : Thomas Bonne
et Franck Hirsch
Photographe : Rémi
Lainé
Montage : Laure
Gardette
Compositeur : Daniel
Bacon
Production : VF et Associés
Producteur : Véronique
Frégosi, Bruno Pésery
Post-production :
Véronique Marchand et Sylvain Foucher
Avec la participation de :
Canal+ , France 2, Télévision Suisse
Normande
Distribution : Mars
Films
Sortie le : 17 avril
2002
Durée : 1h 45
mn
Pays : France
Année :
2001
|
|
|