|
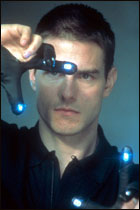 |
|
|
|
Et si l’image de préméditation
se trompait ? Si elle dévoilait à notre insu
? Au bout d’une heure, un second film est mis à nu
: le film mental qui va permettre à John Anderton,
l’espace d’un cillement, d’anticiper l’image le montrant comme
un assassin. Au-delà de la lutte du soldat contre l’empire
(dont il provient), lutte d’un homme en quête de rédemption
(son fils a disparu) que l’on découvre sur un écran
" coupable " d’homicide, Minority report
reste le récit d’une solitude. Si dans A.I. (Artificial
intelligence), dernier film de Spielberg, le petit robot
apprend à évoluer parmi les vivants, John apprend
à vivre avec les morts. Il est question ici d’un émouvant
vacillement et de faiblesses humaines ; il est question de
la froideur d’un cœur tangible, ce qui fonde notre rapport
même aux images, aux fictions intérieures qui
le régit. Comment l’image mentale (le deuil du fils)
préexiste par le manque et comment le manque pénètre
dans l’image visuelle résument clairement la plus émouvante
et théorique des scènes du film : en faisant
du home-cinéma high-tech de John, une projection
mentale du souvenir (comme une plage mentale stockée
en mémoire), Spielberg montre simplement le passage,
l’incarnation du manque, d’une image mentale à son
rendu visuel. Devant le flou-bougé de l’image, rendu
photographique de cet " instant décisif ",
John est en proie à une impuissance généralisée
(gestuelle, affective), qui masque ses émotions tout
en secrétant un manque en lui. Cet insondable manque
est le cœur secret de Minority report : avant que l’on
ne voie son fils, l’enfant incarne l’image manquante. Spielberg
rejoint ainsi la réflexion sur l’image manquante de
De Palma comme point mort, qui sera conditionnée par
la quête d’une preuve par l’image, lorsque John découvre
la photographie de son fils. Un leurre ou une manipulation
de l’image qui bouclent habilement la similitude avec le cinéaste
du (faux) montage.
Quelque chose de tristement
onaniste transparaissait déjà des premiers plans
: gymnastique technique et utilisation manuelle des écrans,
revêtement de gants fétichistes, pyrotechnie
rassurante et érotisée pour une chorégraphie
déshumanisée. Ces gants, avec deux doigts lumineux
qui chacun formatent le cadre, dessinent de splendides courbes
(l’image inutile que l’on jette de côté) ; or,
leur fonction redouble d’importance, par le biais des écrans,
en faisant un lien, tel un rayon invisible, entre les fantaisies
high-tech (le palpable) et une vision du monde déshumanisé
(l’intouchable). Ce qui touche dans Minority report
renvoie à tout ce qui est de l’ordre de l’exsangue.
Ce qui advient de la nouvelle utilisation du corps-manga de
Tom Cruise vivant dans le passé que l’on projette dans
la ville futuriste. Ce qui forme la substance d’une esthétique
aseptisée du chaos, société abstraite
et hors-champ : les trajectoires urbaines d’un corps somnambule
sans cesse en survie. Regard évidé (il va perdre
la vue) puis décharné (chez Philip K. Dick,
le trafic d’œil est roi) : John est un héros désincarné.
Minority report excelle à montrer la naissance
à rebours d’un surhomme démuni et impuissant,
qui se traduit jusque dans son utilisation des écrans
: langueur et vélocité, fléchage et segmentation
de l’espace qui alternent tout en composant un mouvement vif
et langoureux qui dilate l’espace-temps, dépasse l’arsenal
technique jusqu’à la perte de sens. Ce qui est en jeu
ne se mesure plus : passage de l’automate à
l’humain, du froid au chaud (A.I), déshumanisation
finale de l’homme et de la machine. Le monde/chaos s’y réduit
à cela : une chute des murs d’images qui ouvre sur
une vraie expérience de l’intime.
 |
|
Titre : Minority
Report
Réalisateur :
Steven Spielberg
Acteur : Tom Cruise,
Colin Farell, Samantha Morton et Max Von Sydow
Scénario : Scott
Franck et Jon Cohen
Basé sur la nouvelle
de : Philip K. Dick
Directeur de la photographie
: Janusz Kaminski
Chef monteur : Michael
Kahn
Chef décorateur
: Alex McDowell
Chef costumière
: Deborah L. Scott
Superviseur des effets visuels
: Scott Farrar
Musique : John Williams
Production : Twentieth
Century Fox, Dreamworks Pictures.
Produit par : Gerald
R. Molen, Bonnie Curtis, Walter F. Parkes, Jan
De Bont
Sortie France :
2 octobre 2002
Durée : 2h25
|
|
|