D’ailleurs, le film finit sur cette promesse
de livre. Joseph écrit deux mots significatifs sur une
feuille blanche : " Trace " puis " lien "
et ce, devant une fenêtre ouverte sur une fête de
campagne où des enfants jouent au cœur d’un parc vert,
ensoleillé, empli d’espoir…
Ce personnage est
sans doute le double le plus flagrant de Robert Bober dans
le film, devenu documentariste et romancier…
Chaque personnage se révèle donc plus ou moins
nettement dans une séquence-confession qui lui est
consacrée, base même de la structure du scénario.
Dans ou hors atelier, chaque protagoniste parle de son passé,
de ses fantasmes, de ses difficultés. Mais dans ce
procédé narratif choisi, demeure une frustration
pour le spectateur, provenant peut-être d’un manque,
d’une inégalité d’intensité, de contenu
et d’intérêt dans les révélations
de chacun.
Cela vient peut-être du parti-pris de Michel Deville
et du livre de Robert Bober, de vouloir reposer sur la pudeur,
la retenue extrême des sentiments, sur la simple quotidienneté
de ces vies… A moins que l’on mette en cause ici, le jeu même
des acteurs - hormis celui, magnifique donc, de Denis Podalydès
- qui manquerait de conviction, de vérité, de
profondeur… (?)
C’est
pourquoi un pénible sentiment, un malaise même,
se dégage à la vision du film ; celui de
rester en permanence à la surface des personnages et
des moments vécus ou racontés par ces derniers,
alors qu’à priori, tout est là pour parvenir
à nous émouvoir : un casting formidable,
un réalisateur sensible et de talent, un roman solide,
un contexte historique fort concentré dans un lieu
riche, un atelier de couture donc de vie...
On
regrette de connaître si peu, si mal, Léon, le
tailleur-comédien pourtant plein d’humour ; Maurice
et sa maîtresse Simone, la prostituée pétillante,
Jacqueline, la douce mère de famille ou encore la touchante
mais trop peu présente, à peine ébauchée
même, Mme Andrée (belle Julie Gayet)…
Cette
dernière toutefois parvient un peu à se distinguer
lorsqu’elle fait le récit d’un conte enfantin sur la
revendication de la différence, que le réalisateur
met en images au cœur d’une forêt mythique, symbolique…
Etrange passage que celui-là, entre fiction et réalité,
rupture maladroite que le réalisateur place au cœur
du film…
| |
 |
|
|
" Un
Monde presque paisible " est comme désincarné,
détaché de tout contexte et pourtant il nous
parle, veut nous parler de 1946 et de ses juifs survivants.
Il se place dans un entre-deux déconcertant, déjà
au niveau du style, de l’esthétique donc, comme s’il
ne savait choisir entre fidélité à la
réalité, reconstitution historique et narration
plus intime, bouleversante, voire même poétique…
comme s’il n’osait pas le fond et la forme du propos…
Sans pour autant regretter dans ce film un manque de pathos,
on est triste toutefois, de n’avoir pu entrer vraiment dans
l’univers, la sensibilité singulière de Michel
Deville, ce qui est rare…
Mais l’essentiel n’est pas perdu puisque " Un
Monde presque paisible " nous donne l’envie
malgré tout, de revenir au livre initial de Robert
Bober qui l’a inspiré.
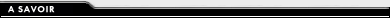 |
|
A lire, à voir :
" L’atelier ",
remarquable pièce de théâtre
de Jean-Claude Grumberg, (Ed. Actes Sud, dans toutes
les bonnes bibliothèques)
|
|
 |
|
Titre : Un monde presque paisible
Réalisation :
Michel Deville
Adaptation : Rosalinde
Deville d’après " Quoi de neuf
sur la guerre ? " De Robert Bober
(Ed. POL)
Lumière :
André Diot
Cadre : Laurent
Dhainaut
Décors :
Arnaud de Moleron
Costumes : Madeline
Fontaine
Maquillage : Laurence
Azouvy
Scripte : Anne
Wermelinger
Son direct : Jean
Minondo
Son auditorium :
Thierry Delor
Montage image : Andrea
Sedlackova
Montage son : Thomas
Desjonquères
Musique : Giovanni
Bottesini
Interprétation :
I Solisti Aquilani
Régie :
Isabelle Arnal
Direction de production :
Franz-Albert Damamme
Production : Rosalinde
Deville
Acteurs : Simon
Abkarian, Lubna Azabal, Zabou Breitman, Clotilde
Courau, Vincent Elbaz, Julie Gayet, Stanislas
Merhar, Denis Podalydès, Malik Zidi
Direction : Vittorio
Antonellini
Production : Elefilm-France
3 Cinéma 2002
Distribution :
Les Films du Losange
Sortie : le 18
décembre 2002
Pays : France
Durée :
1 h 33
|
|