 |
|
|
|
Yamina Bachir Chouikh a
filmé ce tragique fait-divers sous un angle inédit
puisqu’elle déplace une violence urbaine, aveugle,
dans un contexte rural à partir duquel elle peut étudier
le sort de ses compatriotes. Elle s’attache surtout à
relater et dévoiler le mécanisme de la montée
de la peur et de la haine dans cette " micro-société "
et effleure les relations qui se nouent entre les terroristes
et leurs victimes, ou la complicité plus ou moins consentie
de certains algériens, comme la famille de la petite
Karima, une des élèves de Rachida, dont le père
est un terroriste. Elle dévoile les atrocités
meurtrières commises par les commandos du GIA, massacres
de villageois, enfants abandonnés, vol de la population,
les faux barrages, en laissant les bourreaux muets. Ainsi
elle ne réalise ni un documentaire ni un film de propagande,
mais raconte simplement le quotidien sanglant qui bouleverse
l'Algérie.
La cinéaste explique avoir " choisi comme
personnage principal une des victimes ‘préférées’ des
terroristes : une femme ". Avec ce film, elle
dresse le portrait non pas d’une femme, mais celui de " trois
générations d’algériennes "
confrontées au joug des terroristes. Il y a Aïcha,
la mère de Rachida, une femme divorcée, une
paria qui subit la violence de la société et
du poids des traditions. Rachida, est une jeune fille moderne
qui se maquille, écoute de la musique, a un petit ami,
ne se pose pas de questions, comme beaucoup d’Algériens
d’avant la vague terroriste. Yamina Bachir Chouikh dissèque
les réactions de Rachida face à cette peur qui
la meurtrit dans sa chair. Lors de la découverte de
la présence des terroristes dans le village elle est
accablée, étouffée par la réapparition
de ses émotions, mais elle parvient à surmonter
son effroi et finit par recommencer à vivre. Karima,
la plus jeune des trois rêve d’aller sur la lune, elle
représente le futur de l’Algérie, celle pour
qui un autre monde est encore possible. La cinéaste
aborde aussi un autre aspect des conséquences du terrorisme,
le sort d’une jeune fille enlevée et violée
par les terroristes qui a réussi à s’enfuir
et qui retourne chez elle. Le père la répudie
car elle l’a déshonoré. Elle dresse l’état
des lieux d’une " société algérienne
bouleversée " acculée entre des
traditions omniprésentes et son " désir
d’exister ".
| |
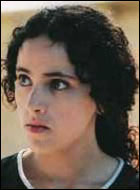 |
|
|
Rachida est une métaphore
sur l’Algérie : comme le dieu Janus, ce pays a
deux visages, une face légère, optimiste et
une autre faite de peine, de sang et de douleur. Cela se traduit
dans la réalisation par des plans de scènes
violentes filmées caméra à l’épaule, contrebalancés
par des scènes de douceurs avec des mouvements lents.
Yamina Bachir Chouikh créé des instants fugitifs
de poésie, comme lorsque les élèves forment
des bulles de savon, ou encore les préparatifs du mariage,
l’escapade amoureuse de Rachida et de son fiancé. Il
existe aussi une scène remarquable de beauté
où les femmes enlèvent leur voile pour en recouvrir
la jeune fille souillée par le viol. Quant il s’agit
de tourner des scènes violentes, elle filme de façon
réaliste, mécanique, sans céder au voyeurisme
ou à l’acrimonie. Les deux femmes se révoltent
contre les terroristes et contre l’Etat. La jeunesse est montrée
dans son quotidien difficile, fait aussi de moments d’insouciance,
à l’instar de cette scène légère
où l'amoureux insatisfait accapare la cabine téléphonique
pour appeler sa bien aimée et s’exclame :" Chaque
pièce est un rêve, le pays lui ne donne que des
cauchemars ". Cette jeunesse qui endure la mauvaise
gestion économique, sociale et politique, est la première
à être touchée par le désœuvrement
et le chômage. " C'est l'aboutissement de toutes
sortes de violences, l'humiliation de nos jeunes, le chômage,
pendant 40 ans, nos enfants ont été élevés
avec des slogans ". Ces faits font partie
des causes responsables de la montée de la haine. Le
même adolescent répliquera au père qui
le refuse comme prétendant à sa fille :
" Ce n’est pas moi qui suis au chômage
c’est l’Etat qui est en vacances ! ".
Comme dans toute tragédie, les moments de bonheur laissent
place à une atmosphère plus lourde, plus implacable,
celle d’une Algérie chaotique et inhumaine. Rachida
se clôt sur le massacre sanglant des villageois par
les terroristes qui déciment une partie de la population
lors de la cérémonie du mariage, laissant le
village dévasté, en ruines, théâtre
de l’armageddon. La jeune institutrice parvient à se
cacher et sauve un nouveau né. Le lendemain, elle retourne
résolument à l'école dans une scène
finale bouleversante où l'on voit les enfants qui ont
échappé au massacre, s’approcher et pénétrer
dans leur salle de classe saccagée. Pour Yamina Bachir
Chouikh, ce film permet aussi de montrer " la dégradation
d’un système éducatif devenu un vivier de violence
où l’on cultivait la culture de la haine ".
Ainsi, dans son œuvre romanesque, l’école reste un
sanctuaire inviolé, un lieu de savoir et de connaissance.
Au début du film, Rachida refuse d’y faire exploser
la bombe. Même si à la fin du film, l’école
subit les foudres des terroristes, il demeure le seul lieu
d’espoir.
Yamina Bachir filme la femme algérienne, belle, valeureuse,
faisant front, et réalise un film brillant et courageux,
un " hymne à la paix, à la tolérance,
et au courage de tous les ‘anonymes’ ".
 |
|
Titre : Rachida
Réalisateur :
Yamina Bachir-Chouikh
Scénariste :
Yamina Bachir-Chouikh
Acteurs : Ibtissem
Djouadi, Bahia Rachedi, Rachida Messaouden, Zaki
Boulenafed, Amel Chouikh, Abdelkader Belmokaden,
Mohamed Remas, Aïda Guechoud, Azzedine Bougherra,
Narimen Laalali
Directeur de la photographie :
Moustapha Belmihoud
Compositeur : Anne-Olga
De Pass
Production : Ciel
Production, Arte France Cinéma, Ciné-Sud
Promotion
Producteur : Margarita
Séguy
Distribution :
Les Films du Paradoxe, France
Date de sortie : 08
Janvier 2003
Pays : Algérie,
France
Durée : 1h 40mn.
Année :
2002
|
|
|