SYNOPSIS :
Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro
dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop
fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas
se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement
violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'oeil
d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel.
Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité. Il souhaite
pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence
son apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale.
Il admire Tignasse et son gang, qui arraisonnent les camions
et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion
de commettre un meurtre, le premier d'une longue série... |
|
....................................................................
|
|
GANGS
OF RIO
| |
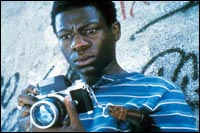 |
|
|
Énorme
succès au Brésil, grosse sensation au dernier festival
de Cannes, La cité de Dieu est un film ambitieux, et
très impressionnant. Adapté d’un livre de Paulo Lins (et d’une
histoire vécue, ce qui lui a valu d’être conseiller sur le
film), c’est une fresque se déroulant sur trois époques, soit
une quinzaine d’années, qui raconte la vie et la trajectoire
de jeunes gens dans l’un des quartiers les plus chauds et
les plus violents de Rio de Janeiro, Cidade de Deus. La part
belle est faite à la violence dans un récit plein de bruit
et de fureur qui s’attache à montrer comment s’édifie un gang
de gamins des rues vivant du trafic de drogue et la lutte
des gangs entre eux.
La cité de Dieu nous invite à un véritable torrent
narratif, doublé d’un tourbillon visuel, étourdissant, saoulant
par moments, explosif, frénétique, parfaitement maîtrisé,
dans lequel on se laisse entraîner sans résistance et qui
fait passer très vite les deux heures quinze que dure le film.
Certes, d’aucuns s’agaceront de quelques tics de mise en scène : musique
omniprésente, lumière léchée d’un Brésil publicitaire etc,
donnant l’impression par moments de voir un clip géant façon
MTV, mais il y a aussi une inventivité et une vitalité extraordinaire
dans la mise en scène de Meirelles (aussi bien le cadrage,
le scénario, le jeu d’acteur, le montage etc), cette vitalité
qui est celle-là même des gamins des favelas et qu’avec Pasolini
on pourrait qualifier de « désespérée ». On sent
aussi manifestement une joie intense de filmer, de faire du
cinéma, qu’on comprend d’autant plus quand on sait que la
plupart des (jeunes) acteurs sont des non-professionnels,
venant eux-mêmes des favelas de Rio. De fait La cité de
dieu, de ce point de vue rappelant parfois Trafic
de Soderbergh, témoigne de cette tension entre le réalisme,
voire l’hyper réalisme, de l’approche du sujet (tournage dans
les lieux réels, acteurs non professionnels etc.) et la stylisation
parfois extrême du traitement formel et narratif, peu avare
de procédés : cadrages élaborés, lumière, montage polymorphe,
arrêts sur image, retours en arrière, alternance de points
de vue, voix off. Après tout, Meirelles aurait pu opter pour
la voie du « tout documentaire » et tourner avec
une pellicule granuleuse genre 16 mm. Mais Cidade de deus
est animé d’une ambition spectaculaire claire et nette, à
la façon d’un grand film d’action américain, comme si d’une
certaine façon il y avait une façon de rendre hommage, de
conférer toute sa dignité et son prestige cinématographique
à des évènements et à des personnages bien réels, morts pour
la plupart, de les doter de l’aura mythologique du cinéma.
Mais surtout c’est cette constante dynamique et fluidité du
récit qui impressionne, celle que Meirelles a réussi à impulser
au film malgré la ramification complexe de l’intrigue, adaptée
d’un livre particulièrement foisonnant. Par moments, le film,
par l’emballement frénétique du récit et sa flambée de violence
finale, fait penser aux meilleurs Scorsese, particulièrement
Les Affranchis. Cette comparaison n’est pas fortuite :
Cidade de deus raconte une histoire très similaire
à Gangs of New York, le dernier Scorsese. Les deux
œuvres montrent le mécanisme d’édification et de maintien
des gangs dans les zones urbaines anomiques et le caractère
fondateur de la violence dans les villes. Mais l’élève a dépassé
le maître et Meirelles réussit là ou Scorsese a échoué :
la fluidité, le rythme, la spontanéité, l’énergie, la simplicité,
alors que chez Scorsese tout paraît empesé et plombé.
|