 |
|
|
|
À
partir d’une matière première particulièrement riche, Meirelles
a choisi de se focaliser principalement sur deux personnages :
Fusée, le narrateur timide et Petit Zé, le caïd psychopathe
et haut en couleurs. Tous les autres gravitent autour d’eux,
et le récit lui-même se structure autour de leur relation
étrange, entre admiration secrète et haine. Fusée est le témoin,
celui qui raconte une histoire à laquelle il a survécu. C’est
pourquoi il ne participe pas à l’action violente qui nous
est relatée, et qu’il reste constamment en retrait, lointain,
quasi inexistant, adoptant une focalisation externe comme
on dit si bien. Il ne vit pas l’action car il préfère la représenter,
à travers la photographie par exemple, sa passion, qui va
lui permettre de s’en sortir et va lui sauver la vie. Dans
un monde qui vit dans l’instant et où l’on meurt très jeune
de mort violente, Fusée est l’homme du temps : celui
qui transmet (l’instance du récit) et celui qui fixe l’instant.
Ainsi Petit Zé, comme vaguement conscient d’une mort proche,
lui demande d’ailleurs de le prendre en photo avec ses potes,
arborant fièrement leurs armes comme pour immortaliser l’instant
et aussi pour avoir sa photo dans le journal. Mais c’est bien
sûr le personnage de Petit Zé qui est la grande figure du
film. Rarement on aura vu un personnage de « méchant »
aussi réussi et convaincant, si ce n’est le personnage de
Joe Pesci dans Les Affranchis : à la fois terrifiant
et touchant, odieux et drôle, psychopathe et innocent, criminel
et enfantin. Une sorte de prince du mal qui sème la mort avec
une sorte de naturel et de facilité déconcertante, en toute
innocence presque. Dans la première partie du film, on le
voit enfant, au cours d’une scène glaçante, tirer en rigolant
sur les membres d’un hôtel et les tuer un à un, sans raison,
pour le plaisir. Et pourtant Meirelles parvient à lui donner
une humanité, notamment à travers sa relation d’amitié passionnelle
avec Carotte, son ami d’enfance, le caïd le plus zen de la
cité dont le calme tempère son ardeur. Lorsque celui-ci meurt
d’une balle perdue dans une discothèque, l’immense détresse
qu’il éprouve est parfaitement rendue, et nous bouleverse.
C’est bien le seul moment du film où l’on voit ce personnage,
par ailleurs mal à l’aise avec les filles, comme souvent les
grands criminels de cinéma, éprouver des sentiments.
| |
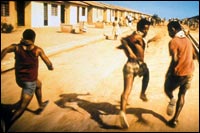 |
|
|
Au
fond, le grand intérêt de Cidade de Deus, au delà de
ses qualités de film de gangsters, tient à la façon
dont il révèle le mécanisme infernal et infini de la violence,
condamnée à se répéter encore et toujours. Elle repose sur
le ressort universel de la rivalité mimétique : ces gosses
des rues passent leurs temps à s’entretuer non parce qu’ils
sont différents mais parce qu’ils sont les mêmes et qu’ils
désirent ce que désirent les autres. Petit Zé finira abattu,
non par la police qui le couvre, mais par des gamins des rues
qui lui ressemblent. C’est déjà ce que tendait à montrer La
vierge des tueurs de Barbet Schroeder, où les deux jeunes
criminels, proches à bien des égards des jeunes de La cité
de Dieu, s’avéraient identiques. Dans ce type de communauté,
il y a une composante homosexuelle évidente qui structure
les rapports sociaux, et l’on remarque l’absence quasi totale
des filles. C’est que celles-ci, amantes ou mères, portent
des valeurs de douceur et de paix, qui risquent d’interrompre
ce processus de la violence. Lorsque Carotte noue une liaison
avec une fille, il s’éloigne irrémédiablement de Petit Zé
et semble de plus en plus enclin à la non violence. Mais le
film montre aussi comment, dans ce processus-là, le temps
est comme arrêté, saisi dans la fureur de l’instant, pris
dans le cercle sans fin de la violence , dans la perpétuelle
répétition du crime et de la vengeance. Autrement dit, c’est
une communauté qui ne s’inscrit pas dans une continuité, dans
une chaîne, dans une tradition : elle est aussi irrespectueuse
du passé qu’indifférente à l’avenir. C’est une société de
jeunes, voire d’enfants, qui ne tient pas compte des aînés,
privé de pères : « les pères, ca ne dit que des
conneries » dit l’un des personnages au début du film.
Fusée est celui qui, de lui-même, interrompt ce mécanisme
infini (c’est aussi pour ça qu’il survit à tout ce massacre)
puisqu’il ne venge pas son frère tué par Petit Zé. À ce sujet,
le film ne se berce pas d’illusions, n’ignorant pas la situation
actuelle du Brésil, même si un changement de Président laisse
planer certaines espérances, et finit sur une scène relativement
pessimiste, du moins fataliste : des enfants armés de
flingues arpentent la rue, évoquant leurs projets de meurtre
sur des membres de gangs rivaux.
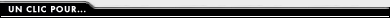 |
|
 |
|
Titre : La Cité de Dieu
Titre VO : Cidade
de deus
Réalisateur : Fernando
Meirelles, Katia Lund
Scénariste : Braulio
Mantovani
D'après l'oeuvre de
: Paulo Lins
Acteurs : Alexandre
Rodrigues, Douglas Silva, Phelipe Haagensen, Leandro
Firmino Da Hora, Seu JorgeManu, Jonathan Haagensen
Directeur de la photographie
: Cesar Charlone
Compositeur : Antonio
Pinto
Monteur : Daniel Rezende
Producteur : Walter
Salles
Production : 02 Filmes,
VideoFilmes
Distribution : Mars
Distribution
Interdit aux moins de
: 16 ans
Date de sortie : 12
Mars 2003
Pays : Film brésilien
Année : 2002
Durée : 2h 15mn
|
|
|