REQUIEM
| |
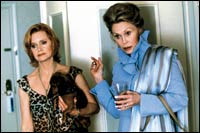 |
|
|
Ne vous fiez jamais aux apparences.
En allant voir Les lois de l’attraction, on est en
droit d’avoir peur. La lecture du synopsis et la présence
d’un casting qui sort tout droit d’un film pour ados laisse
augurer un énième teenage movie sans âme avec, convention
oblige, son lot de digressions potaches et de gags scatos
pas nécessairement poilants. Tout faux : Les lois de l’attraction
est précisément un film intelligent et malin qui, pendant
près d’une heure, fait semblant d’accumuler tous les poncifs
du teenage movie, et même ceux les plus détestables, pour
dans un second temps, les retourner et en faire émaner la
totale stupidité. Résultat : Les lois de l’attraction est
un film très fort qui risque de sérieusement perturber ceux
qui s’attendaient à une resucée de American Pie.
Tout d’abord, Les lois de l’attraction est l’adaptation
d’un roman éponyme de Bret Easton Ellis, romancier sulfureux
dont le style est virulent, corrosif, méchant, misanthrope…
et malgré tout, très caustique. On a toujours été sceptique
à la transposition au cinéma de ses romans tant il est impossible
de retranscrire concrètement les perles d’insanités qui s’y
trouvent. Impression confirmée il y a peu par American
Psycho, tristement adaptée par Mary Harron qui, ne pouvant
pas mettre en scène toute la violence du livre à l’écran,
s’est contentée d’établir un faux règlement de compte aux
vilains machos. Ce qui était à la fois ridicule et hors propos.
Qu’on se rassure : Roger Avary a été sur ce coup nettement
plus inspiré que la réalisatrice de I Shot Andy Warhol
et ce, à tous points de vue.
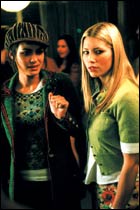 |
|
|
|
Coscénariste du Pulp Fiction de
Tarantino et déjà auteur d’un premier long déjà sérieusement
azimuté baptisé Killing Zoe, Avary dynamite les lieux
communs et refuse de servir une fiction ridiculement pro-jeuniste.
Les Lois de l’attraction n’est pas un film aimable,
sympa, cool… Bien au contraire : il creuse en profondeur,
met sens dessus dessous et surtout, fait montre d’un pessimisme
qui met profondément mal à l’aise. Mais attention : Avary
châtie le mélo pleurnichard et le pathos malvenu grâce à
un humour cruel et grinçant qui tourne en dérision des situations
douloureuses ou même des personnages, prisonniers de leurs
apparences, enfermés dans des codes trop bien définis, à
l’instar du gay qui écoute du George Michael ou de la blonde
vulgaire qui met un peu trop de Q dans son I et passe son
temps à se droguer frénétiquement.