| |
 |
|
|
Telle n'est pas la démarche de Claire
Simon avec Mimi. La documentaliste rejette toute
dimension événementielle. Le tournage ne correspond pas
à un moment particulier de la vie de son héroïne, ce n'est
que l'instant choisi par la réalisatrice pour faire une
sorte de bilan de l'existence de cette dernière. Claire
Simon nie l'extraordinaire pour se consacrer au banal, à
la vie d'une femme dont l'existence n’est pas véritablement
hors du commun. Le père de Mimi Chiola est mort d'une occlusion
intestinale pendant la Seconde guerre mondiale. Il avait
été blessé quelques jours auparavant par une mine alors
qu'il cueillait des citrons dans un jardin à l'accès gardé
par des soldats allemands. Le chef de famille n'arrivait
plus à subvenir aux besoins alimentaires de sa famille.
Il apportait parfois des rats à sa femme et à ses deux enfants,
en les leur présentant comme des cochons d'Inde achetés
sur le marché noir. Mais au fil des mois les rats ne suffisaient
plus. Les citrons gorgés du soleil niçois en paraissaient
d'autant plus alléchants.
Blessé par des éclats, il est resté plusieurs semaines dans
son lit, en convalescence. Un jour, une voisine croyant
bien faire lui proposa un morceau de pain. Le père de Mimi
avait faim, mangea le pain et en mourut. L'histoire est
tragique, mais n'a malheureusement rien d'extraordinaire.
Durant la Seconde guerre mondiale, les drames humains de
ce type, et des bien plus affreux, ont été nombreux. S'il
fallait faire le portrait de tous ceux qui ont perdu leur
père pendant cette sombre période, les cinémathèques déborderaient
de toutes parts.
 |
|
|
|
Autre élément majeur de la vie de
Mimi : son lesbianisme. Claire Simon retrace le parcours
amoureux de son héroïne, de ses premiers émois à ses plus
récentes flammes. Mimi raconte différentes anecdotes sentimentales,
de ses fantasmes d'enfant à ses passions d'adulte, de ses
liaisons successives avec une cousine joueuse de tennis,
une collègue de travail aux formes généreuses, ou une inconnue
rencontrée en pleine rue et quittée sans un mot sur le quai
d'une gare. Mais là aussi, cet attrait pour les femmes n'a
rien d'exceptionnel. Si l'on devait réaliser un documentaire
sur chacune des lesbiennes de France et de Navarre, les
critiques de cinéma décéderaient tous d'hyperactivité.
Claire Simon fait de cette banalité le centre de son récit.
Elle préfère filmer une personne sortie de la masse qu'une
célébrité, espérant faire jaillir de son documentaire un
concentré d'humanité et une certaine forme d'universalité.
Il est vrai que les joies et les peines ressenties par Mimi
et évoquées dans son portrait filmé ne sont pas très éloignées
de celles qu'un spectateur lambda connaît lui-même. Le phénomène
de transfert est alors censé fonctionner à plein. Mais comme
dans son premier film 800 km de distance romance,
où la réalisatrice mettait en scène la relation amoureuse
qu'entretenait son adolescente de fille avec un garçon habitant
loin du domicile parisien familial, Claire Simon échoue
dans son entreprise faute de véritable sujet.
| |
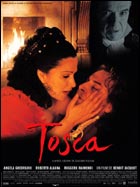 |
|
|
Mimi possède des qualités
cinématographiques indéniables. Les mouvements panoramiques
partant de l'héroïne pour se fixer sur le décor avec Mimi
continuant en fond sonore de raconter sa vie sont remarquables.
Même s'ils deviennent à la longue quelque peu systématiques.
Replacer dans les lieux où ils se sont produits les événements
qui ont marqué la vie de Mimi ou bien les transposer dans
des endroits différents pour en faire resurgir certains
aspects est une idée intéressante. En effet, cela permet
de parler du fonctionnement de la mémoire sans entrer dans
une réflexion intellectualisante.
La mise en situation des bouts d'existence de Mimi, le long
d'une voie ferrée ou au bord d'une rivière, montre combien
les souvenirs fonctionnent à partir de lieux, d'ambiance,
de sons et de parfums. Et le simple fait de se trouver à
l'endroit exact où l'on se tenait quelques dizaines d'années
auparavant et d'y ressentir des sensations analogues détient
une force d'évocation impressionnante. Et presque inquiétante,
car elle indique que l'eau a beau passer sous les ponts,
les souvenirs sédimentent et s'accrochent en profondeur
pour mieux réapparaître à la moindre période de sécheresse
affective.
D'autres dispositifs mis en place par Claire Simon sont
moins heureux. L'utilisation de la musique comme élément
du récit est ainsi particulièrement ratée. Passer Tosca
en surimpression sonore d'un long et ennuyeux travelling
le long d'une rocade niçoise ressemble plus à du remplissage
qu'à l'expression d'une idée précise. De même, les apparitions
épisodiques de deux musiciens, Mohammed Mokhtari au violon
et Diego Origlia à la guitare, sont extrêmement artificielles.
Supposées souligner la culture méditerranéenne de Nice,
ces interventions musicales sont à chaque fois hors sujet.