SYNOPSIS :
Vingt-quatre ans après la disparition
de sa fille dans des circonstances encore inexpliquées,
Aï, aujourd’hui âgée, apprend que celle-ci
a sans doute été retrouvée par la police.
Pourtant le doute subsiste : la jeune femme, amnésique,
est-elle réellement Masako ? |
|
....................................................................
|
|
POINT DE VUE
Pour Kiju Yoshida
qui, après bon nombre de ses compagnons de la Nouvelle
Vague française aux Cahiers du Cinéma
(Truffaut en tête après l’héritage de
Doniol-Valcroze), a débuté sa carrière
en critiquant pied à pied les films de la génération
qui l’avait précédée, l’écriture
cinématographique n’atteint littéralement la
grâce qu’avec une immersion entière de l’auteur
dans son œuvre, contre les films de commande, contre le conformisme
qui devait, dans les années 60, prendre possession
des grands studios japonais, dont la Sochiku de Shiro Kido.
Ce n’est pas un hasard si en 1969 Kiju Yoshida consacrait
un film au révolutionnaire Sakae Osugi (1),
dont la tragédie personnelle faisait écho à
la fois au tremblement de terre du Kantô qui ravagea
le pays en 1923, et à la répression dans le
sang des principaux mouvements syndicaux ou anarchistes japonais.
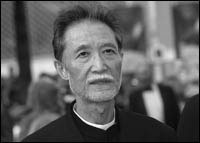 |
|
|
|
Les grandes étapes
qui jalonnent la transformation de la société
japonaise se lisent ainsi à l’orée de combats
individuels. De la même manière que l’engagement
de Sakae Osugi allait être repris par ses anciens compagnons
d’armes, les ombres qui parcourent Femmes en Miroir,
les souvenirs des victimes de la bombe et de leur souffrance
impossible à représenter, se superposent à
ceux de la jeune femme, disparue après avoir donné
naissance à une petite fille, puis réapparue
avec le nouveau siècle.
Dans le visage féminin fractionné par le miroir
brisé, l’image cassée de Masako - Yohiko Tanaka
- impuissante à retrouver son identité dans
le visage de la mère, presque entièrement dissimulée
par l’ombrelle qui la protège du soleil de Tokyo, l’image
ne permet souvent qu’une tentative d’interprétation
de la part du spectateur, à la manière du symbole.
Le personnage de Masako, à la fois mère et fille,
et qui, pense-t-on, permet d’assurer symboliquement la transition
entre la génération qui a souffert des bombardements
et de la " pluie noire " et celle qui
n’a jamais connu ni guerre ni privation, n’apporte pas l’équilibre
espéré. Bien au contraire, le retour inespéré
rend patentes de trop nombreuses interrogations, et les maigres
indices que celui-ci donne de la véritable identité
de la femme présentée comme la fille d’Aï
ne permettent d’établir aucune certitude, si ce n’est
ce lien avec la ville d’Hiroshima.
|