SYNOPSIS :
Raphaël aime Margot et celle-ci le lui rend bien. Mais un jour,
Margot, danseuse étoile au sommet de sa carrière et de son art,
se sait condamnée par la maladie. Entre désespoir et rage, renoncement
et révolte, les deux amants choisissent instinctivement de brûler
leur amour fou... |
|
....................................................................
|
POINT DE VUE
| |
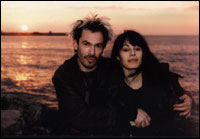 |
|
|
Quand je vois le soleil n’est ni
un film sur le milieu de la danse comme pouvaient l’être La
Mort du cygne (1937) de Jean Benoit-Lévy ou Le Tournant
de la vie (1977) d’Herbert Ross, ni, à proprement parler,
un film de danse : les séquences brillamment dansées (cf.
par exemple la magnifique variation sur la chanson de Léo
Ferré, “ Avec le temps ”) par Marie-Claude Pietragalla
sont donc très brèves, accessoires, ce qui frustrera son public
de balletofans. C’est avant tout un film de comédiens,
avec, dans l’ensemble, une remarquable distribution et, en
particulier, une excellente prestation de Florent Pagny dans
un registre minimaliste efficace. Connu surtout comme chanteur,
celui-ci, qui, n’était sa coiffure kitsch, passerait
inaperçu dans la vraie vie (dans la rue), est presque naturellement
doué de photogénie ; il fait honneur à
son compatriote Nicéphore Niépce. Avec aussi la révélation,
dans tous les sens du terme, y compris dans son sens photographique,
d’une danseuse classique devenue comédienne qui s’inscrit
dès sa première apparition à l’écran dans la lignée des Janine
Charrat, Mia Slavenska, Yvette Chauviré, Leslie Caron et autres
Zizi Jeanmaire (n’oublions pas au passage Brigitte Bardot
et Mathilda May qui ont débuté dans la même discipline artistique).
Pietragalla passe avec succès l’épreuve du cinématographe.
On connaissait l’étoile de la danse, on peut affirmer qu’une
star est née. Une artiste dramatique, voire une tragédienne.
Le sujet du film n’est qu’un prétexte,
un cadre dans lequel viennent s’inscrire par petites touches
les trouvailles formelles du cinéaste, sa manière, et
sa conception de la direction d’acteurs. Pas plus qu’ailleurs,
il n’a ici grande importance : un couple bobo-provençal
(Marie-Claude Pietragalla, Florent Pagny), vivant en dehors
de Phocée, apprend par leur meilleur ami ( François Cluzet)
qui, fort opportunément, est médecin, que la mariée est atteinte
d’un cancer irrémédiable à progression relativement rapide
(1h30). Nous sommes loin du film militant féministe traitant
du sujet du cancer du sein (cf. Murder and Murder (1996)
d’Yvonne Rainer par exemple). Le ressort de ce mélodrame ne
réside pas dans une quelconque opposition sociale (clans familiaux
dans la tradition de Roméo et Juliette ou de Love
Story) mais plutôt dans la décomposition même, lente et
inexplicable, du désir. Le dégoût et la corruption sont d’ailleurs
signifiés par un rituel proto-catholique à base d’aspersions
purificatrices auxquelles se livre à la moindre occasion la
jeune femme. Pour lutter contre la maladie, la mort (cf. le
choc ressenti par le personnage féminin du film à la vision
d’une malade en traitement dans l’hôpital), cette dernière
cherche à contrôler la situation (à mener la danse) et imagine
ainsi un certain nombre de stratagèmes ou de jeux érotiques,
rétribués ou gratuitement offerts au mari par une partenaire
consentante (Sophie Broustal) destinés à stimuler celui-ci
et, en quelque sorte, à lui faire vivre son deuil par avance...
|