| |
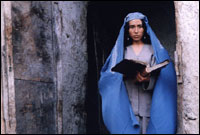 |
|
|
Nogreh est le personnage principal du film
mais c’est un trio qui se trouve réellement au cœur du film.
Chacun a un rôle bien précis sans pour autant tomber dans
la caricature. Le père, un vieillard fatigué très pieux incarne
l’Islam traditionnel. La belle-fille qui attend inlassablement
son mari camionneur et tente de faire vivre son bébé affamé
incarne toute la misère qui s’est abattue sur le pays. Nogreh,
elle, incarne l’espoir d’un changement futur.
Tour à tour chassée par des réfugiés pakistanais, la famille
de Nogreh n’a plus de toit. Le père fuyant les « blasphèmes »
qui surgissent partout dans la ville de Kaboul, décide d’emmener
ses filles à Kandahar et les entraîne dans une traversée du
désert apocalyptique et vaine.
Le temps, comme la chaleur du désert, se fait de plus en plus
pesant, de plus en plus lourd. Il attaque les personnages
dont la déchéance et l’agonie physique et morale se fait de
plus en plus forte, jusqu’à la fin avec le poème de Garcia
Lorca qui donne son titre et la touche finale au film :
« A cinq heures de l’après midi (…) tout le reste
était mort. » La situation historique tragique aura
eu raison des personnages.
L’Afghanistan marqué du sceau du fanatisme
religieux
 |
|
|
|
Ce troisième long métrage de Samira Makhmalbaf
est sans doute son film le plus pessimiste mais aussi celui
qui pousse aussi loin le mariage entre fiction et documentaire.
Loin des clichés médiatiques, la cinéaste dresse un état des
lieux terrifiant de l’après régime Taliban, laissant percevoir
à quel point les esprits portent toujours les profonds stigmates
du fanatisme religieux qui a marqué le pays au fer rouge.
Elle démontre ainsi que la démocratie est un processus lent
qu’une action militaire ne peut amener du jour au lendemain.
Une réflexion qui fait écho à l’actualité du moment avec le
conflit américain en Irak.
Les critiques ont souvent reproché à Samira Makhmalbaf et
à son père d’esthétiser à outrance leurs films. Au contraire,
ici, ce choix visuel donne du sens à la construction narrative.
Il fait partie d’un des procédés utilisés par la réalisatrice
pour précisément échapper à la démonstration complaisante.
Il en va de même pour les enchaînements de scènes visuellement
très efficaces, chargés d’un bleu vif ou construits en formes
noires et blanches, ainsi que des décors (palais en ruine,
épave d’avion) qui traduisent la désorientation de la famille
et plus largement de la population.
| |
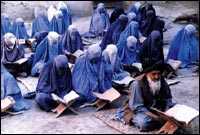 |
|
|
Une propension à l’emphase qui n’était pas
présente dans ces précédents longs métrages mais qui démontre
toute l’urgence d’un questionnement au cœur du film, à savoir
est-ce que ce pays profondément marqué par l’islamisme fanatique
parviendra à trouver une alternative entre le modèle occidental
et les tabous propres à la culture islamique. Au-delà, cet
essai poétique réveille surtout la douloureuse problématique
du devenir de l’Afghanistan après la chute du régime Taliban.
 |
|
Titre :
A cinq heures de l’après midi
Réalisateur :
Samira Makhmalbaf
Scénariste :
Samira Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf
Acteurs : Agheleh Rezaie,
Abdolgani Yousefrazi, Razi Mohebi, Marzieh Amiri
Image : Ebrahim
Ghafori
Montage : Mohsen
Makhmalbaf
Son : Behroz Shahamat
Musique : Mohamad Reza
Darvishi
Producteur : Mohsen
Makhmalbaf
Producteur exécutif :
Syamak Alagheband
Distribution :
Bac Films
Date de sortie :
20 Août 2003
Durée : 1h 46
Année : 2002
Pays : Iran
|
|
|