SYNOPSIS :
Après la chute du régime des talibans en Afghanistan, la vie
reprend son cours dans un pays dévasté par la guerre, entre
l’espérance nouvelle pour les femmes, encore soumises au tchadri
qui accompagne leur accès à l’enseignement, et la persistance
des entraves traditionnelles entourant le noyau familial. Une
femme décide de devenir présidente de la République… |
|
....................................................................
|
POINT DE VUE
| |
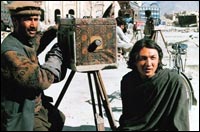 |
|
|
Samira Makhmalbaf, jeune cinéaste iranienne
– virtuose - de 23 ans a, pour son troisième long métrage
- après La Pomme en 1998 et Le Tableau noir prix
du jury au festival de Cannes en 2000 -, installé sa caméra
dans le Kaboul de l’après régime des talibans. A cinq heures
de l'après-midi s'inscrit dans la continuité de son court
métrage réalisé pour le projet collectif 11’09’01.
Son dernier film est une manière de répondre aux « fausses
informations propagées par le tourbillon frénétique de la
politique et des médias » et renvoie aussi à l’œuvre
réalisée par son père : Kandahar. Elle montre
ainsi les tourments d’un Afghanistan débarrassé des talibans,
écartelé entre la persistance de l’influence des traditions
et son aspiration à la liberté. La cinéaste sous-tend son
propos par une mise en scène construite autour de symboles,
contrebalancés par des moments d'humour fugitifs qui laissent
paraître une sensibilité authentique pour l’humain. Les acteurs,
s’ils sont non professionnels, n’en sont pas moins remarquables,
notamment la performance saisissante de Noqreh (Agheleh Rezaie)
interprétant une afghane opiniâtre et résignée. Ce
personnage principal féminin « a été très difficile
à trouver car les Afghanes ne voulaient pas montrer leur visage ».
La réalisatrice raconte que lorsqu’elle demandait « aux
jeunes filles et aux femmes si elles voulaient jouer dans
le film, elles rougissaient et s’enfuyaient, car jouer signifiait
danser, et que c’était contraire à leur culture traditionnelle ».
Samira Makhmalbaf met en scène avec poésie le destin de trois
personnages (le père, la fille, la belle fille) avec pour
écho les quelques vers d’un poème de Garcia Lorca « A cinq
heures de l'après-midi ». Le père incarne le passé, la
vieille génération vivant un islam traditionnel. Sa belle
fille, avec son enfant agonisant, qui espère vainement le
retour de son mari, personnifie le présent, à savoir une population
meurtrie par la guerre. Noqreh, rêve d’émancipation et veut
transformer la société, symbolise le futur.
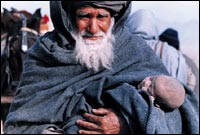 |
|
|
|
Ici, les femmes sont contraintes de respecter
de nombreux interdits : se voiler en présence des hommes,
ne pas danser pour dissimuler leur beauté, « ne pas
se montrer fait également parti de leur culture ». Les
hommes, s'ils voient un visage «nu», se retournent et font
face à un mur, et comme le clame le père : «dis aux
hommes pieux de fermer les yeux». Ce dernier qui est un
homme religieux, pieux, affirme que le « blasphème est
partout dans la ville », depuis la chute des talibans.
L’héroïne est tiraillée entre son quotidien difficile, dominé
par la survie et son désir d’émancipation. Elle suit des cours
en secret car son père bigot s’y opposerait. Hors de la surveillance
paternelle, Noqreh parcourt Kaboul à visage découvert. Lors
d’une cérémonie immuable, elle relève son tchadri et troque
ses souliers contre une paire d'escarpins. La réalisatrice
filme l’enchantement qu’éprouve Noqreh à écouter la répercussion
de ses talons sur le sol. Cet artifice filmique symbolise
la reconquête d’une féminité longtemps entravée par les interdits.
Ce n’est plus désormais une victime de la guerre, contrainte
à l’errance, mais c’est une femme. C’est l’un des rares moments
du long-métrage où elle marche avec un but qu’elle s’est elle
même fixée.
|