Dans son école, la directrice met en
place un jeu civique par le biais duquel les jeunes femmes prennent
la parole en public et expliquent quelles réformes elles entreprendraient
si elles étaient amenées à assumer des responsabilités politiques.
Noqreh se prend au jeu et rêve alors de devenir la Benazir Bhutto
d’Afghanistan. Elle désire améliorer le statut de la femme afghane.
Le personnage de
l’institutrice constitue une des figures itératives du cinéma
de Samira Makhmalbaf, comme dans le Tableau noir, le
référent éducatif constitue l’unique moyen de lutter contre
l'obscurantisme. Ce sont les femmes qui détiennent les clés
du savoir et assument sa transmission. Noqreh se passionne
alors pour la politique et questionne sur leurs opinions politiques
tous ceux qu’elle rencontre, ce qui engendre un dialogue burlesque
avec un soldat français de l’ONU à propos des dernières élections
présidentielles.
 |
|
|
|
Alors que l’Afghanistan
nous a été présenté par une certaine partie des médias comme
« libéré », la cinéaste iranienne dresse un constat
douloureux d’une société toujours profondément marquée par
le poids du fanatisme religieux. Samira Makhmalbaf affirme
« Je n'ai pas voulu parler de politique. Je pense
que lorsque l'on est auteur, réalisatrice, il faut parler
de la condition des gens, de ceux qui vivent en Afghanistan,
plutôt que de politique ». Le personnage de Noqreh
est une parabole de l’Afghanistan et de ses contradictions,
un pays écartelé entre l’espoir naissant des avancées et le
traditionalisme patriarcal, toujours omniprésent. L’oppression
d’une domination masculine ancestrale provoque chez Noqreh
des moments de doutes où elle ne croit plus en son hypothétique
ascension sociale et en la possibilité de faire évoluer les
esprits. Elle se débarrasse alors avec colère de ses chaussures
à talons, emblème de son émancipation. L’émergence d’une nouvelle
génération qui tente de réduire les interdits amène le crépuscule
du monde séculaire du père. Ce dernier, sans abri et sans
repères, ébranlé par les bouleversements de la société, doute.
Aveuglé par le poids des traditions historiques qui l’habitent,
il quitte la ville qu’il ne reconnaît plus, pour rejoindre
Kandahar qu’il imagine être toujours « une ville musulmane ».
On assiste alors dans cette traversée du désert à la déchéance
physique et morale des protagonistes, la belle-sœur voit son
enfant se mourir dans la nuit. Le visage de Noqreh n’affiche
plus alors aucune émotion et la persuade que Dieu est mort.
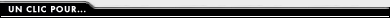 |
|
 |
|
Titre :
A cinq heures de l’après midi
Réalisateur :
Samira Makhmalbaf
Scénariste :
Samira Makhmalbaf, Mohsen Makhmalbaf
Acteurs : Agheleh Rezaie,
Abdolgani Yousefrazi, Razi Mohebi, Marzieh Amiri
Image : Ebrahim
Ghafori
Montage : Mohsen
Makhmalbaf
Son : Behroz Shahamat
Musique : Mohamad Reza
Darvishi
Producteur : Mohsen
Makhmalbaf
Producteur exécutif :
Syamak Alagheband
Distribution :
Bac Films
Date de sortie :
20 Août 2003
Durée : 1h 46
Année : 2002
Pays : Iran
|
|
|