 |
|
|
|
Le fait que les femmes assument
seules les enfants révèle un déficit d’image paternelle.
Situation paradoxale pour une société patriarcale, où les
hommes peuvent avoir plusieurs épouses. L’homme trouve la
légitimation de son autorité par son rôle de protecteur.
Or, aucun homme dans le film n’est un protecteur, excepté
Samba. Il est d’ailleurs le seul qui ne réclame rien en
retour, pas même l’amour de la petite Ndèye. Ainsi, le mari
de Ndaxté a perdu son rôle économique, puisqu’il est au
chômage. On soupçonne là l’origine de son comportement violent.
Il avoue ne pas pouvoir s’occuper seul des enfants, mais
refuse de les rendre à leur mère, qui elle pourrait les
assumer. De même, le père de Mati accepte de l’argent de
la part de Naago, mais chasse sa fille lorsque celle-ci
tombe enceinte du policier. A partir de ce moment il disparaît,
de même que le père de Ndèye n’apparaît jamais. Il n’y a
pas dans le film rétablissement de l’image paternelle, mais
délitement progressif. On peut alors se demander ce que
vont devenir les fils, comment ils vont construire leur
identité. D’autant que Mati finit par disparaître également
de la vie de ses enfants.
Un chœur accompagne le déroulement de l’intrigue. Figurants
internes à la narration, ils l’accompagnent de leurs chants,
variations sur le thème de la perdrix que Mati personnifie.
Ils perpétuent le récit traditionnel africain tout en faisant
écho au théâtre antique. La forme narrative atteint un certain
universalisme. On trouve même des accents de comédie musicale
lorsque Ndèye entonne une chanson sur fond de musique de
fosse.
| |
 |
|
|
La métaphore musicale ainsi que
le flash-back marquent fortement le récit, en dissèquent
les étapes. Il y a là une volonté explicative, un soupçon
de didactisme qui plombe parfois le film. Les dialogues,
aux phrases très construites, créent des scènes « théâtrales »
au mauvais sens du terme. L’action est remplacée par la
parole et les personnages s’expliquent eux-mêmes au lieu
de se révéler.
Le film semble poussé par la nécessité de montrer les drames
du quotidien dans une société où la femme est centrale et
pourtant négligée par l’homme. De cette nécessité résulte
une belle énergie, mais aussi une trop grande volonté de
démonstration. Reste la photographie qui insiste sur les
couleurs et provoque un saisissant contraste entre la beauté
visuelle et les difficultés du quotidien.
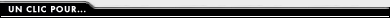 |
|
 |
|
Titre : Madame
Brouette
Réalisateur
: Moussa Sene Absa
Scénario
: Moussa Sene Absa, Gilles Desjardins
1er assistant réalisateur
: Pierre Magny
Acteurs :
Rokhaya Niang Aboubacar Sadikh Ba Kadiatou Sy,
Ndèye Seneba Seck
Scripte
: Claudette Messier
Direction de la photographie
: Jean-Jacques Bouhon
Direction artistique
: Moustapha Ndiaye
Direction de production
: Danielle Champoux
Montage
: Mathieu Roy-Decarie
Son
: Philippe Scultety
Musique
: Serge Fiori et Madou Diabate
Costumes
: Fatou Kande
Direction de post-production
: Joe Yared
Production :
Productions La Fête, MSA Productions, Productions
de La Lanterne
Producteurs :
Rock Demers, Danielle Champoux, Chantal Lafleur
Claude Gilaizeau Moussa Sene Absa, Badou Ba
|
|