|
Le film est partagé entre deux mouvements
contradictoires, celui d’une narration classique avec ses
personnages traversés de récits de vie à la fois pathétiques
et romanesques, chronique de vie, et une vibration musicale
plus aléatoire, aux chemins de traverses imagées, fragments
d’éclats lumineux, de sensations visuelles gratuites et enfantines.
Ce qui traverse le film est cette naïveté, presque violente
tant sa candeur touche, en l’utopie d’un regard neuf, d’une
nouvelle génération qui crée de la beauté là où l’adulte ne
perçoit que le passé douloureux d’une impossible réconciliation.
Le cinéaste octroie à la caméra cette vertu fondamentale de
poétique du regard.
 |
|
|
|
Même si l’enfant s’en empare
presque instinctivement lorsqu’un incendie se déclare au bidonville,
assignant au cinéma le rôle de témoin impuissant qui vient
toujours après, l’engagement du réalisateur pour le cinéma
se situe du côté du romanesque, d’une recréation du monde,
et du choc esthétique comme révélateur de la beauté. A la
critique sociétale tout en finesse, portée par une certaine
et nécessaire espérance politique, d’une nouvelle génération
qui refuse de supporter l’amertume et les blessures des parents
toujours enclins à la ségrégation, se réfléchit presque en
miroir un parcours intimiste fait de divagation visuelle,
au plaisir aléatoire du fragments de couleurs et d’éclats
que l’enfant à la caméra capte tel un émerveillé du monde.
Il y a un effet clip qui fonctionne, tablant sur l’éphémère
du plaisir scopique et musical. Avec, à la périphérie et comme
damné dès qu’il se saisit du revolver, Sipho, grand corps
dégingandé au rire fêlé. Il serait la mauvaise conscience
de tout un chacun, corps abusé, corps drogué, corps violé,
corps africain qui rapp et blues dans les parkings glauques,
veillée d’adolescents indiens où la caméra ne peut que buter
sur leurs visages déjà flétris mais si beaux. Sipho rejoint
tous les Tony Montana (Scarface) que la société libérale
a créé et qu’elle exécute sous l’œil des caméras de télévision.
L’obscénité politique du regard affleure dès lors pour Madiba :
comment filmer le monde ?
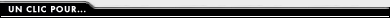 |
|
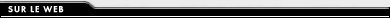 |
|
|
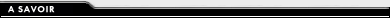 |
|
Ntshaveheni Wa Luruli
est né le 28 août à Johannesburg en Afrique du Sud.
Il entreprend des étude supérieures à l‘université
sud-africaine de Witwatersrand puis à l‘université
Columbia de New York où il apprend la mise en scène,
entre autres dans la classe de Milos Forman. Il
a été assistant- réalisateur Spike Lee sur deux
longs-métrages, la biographie du célèbre et controversé
leader noir américain Malcom X en 1992, et
Jungle Fever en 1991 Il réalise son
premier long-métrage Chikin Biznis en 1998
qui obtint plusieurs prix dans divers festivals
internationaux et The Woden Camera (La
caméra de bois) en 2003. Son prochain long-métrage
en cours de production s’intitule Salina’s People,
c’est l’histoire tout en contradictions sur les
rapports humains par le récit d’une nounou noire
qui nourrit au sein enfants noirs comme blancs jusqu’à
que ceux-ci deviennent les maîtres.
|
|
 |
|
Titre : Caméra de Bois
Réalisateur : Ntshavheni
Wa Luruli
Scénario : Yves Buclet
Co-scénariste : Peter
Speyer
Interprétation : J. Singo,
I. Msimango, D. de Agrella, L. Petersen, N.Jara,
J.P. Cassel...
Directeur de la photographie
: Gordon Spooner
Montage : Kako Kelber
Musique : Phil Sawyer
Costume : Leigh Bishop
Producteur : Olivier Delahaye
et Hervé Houdart
Coproducteurs : Ben Woolford,
Richard Green
Production : Cies ODELION,
Tall Stories, RG&A
Distribution : Eurozoom
Sortie nationale : le
28 juillet 2004
Infos : France, Afrique
du Sud, Grande-Bretagne
Durée : 90min - 35mm
– Couleur - V.O sous titré français
|
|
|