Le 17 avril 1998, Simon de la Brosse
nous a donné sa vie en se donnant la mort. Quelques années
plus tard, il est normal qu’un hommage lui soit rendu à
travers son propre exemple, qui illustre le propos précédent.
L’heure de gloire n’a pas empêché cet acteur de
mettre fin à ses jours, et l’art, s’il est cathartique,
le fut peut-être pour les spectateurs de ses films, mais
pas pour lui-même.
|
Dans le film qui a
inspiré la naissance de notre revue, Travelling-Avant,
de Jean-Charles Tacchella, Donald, son personnage déclarait
dans les premières scènes :
" J’aime ce film, mais il ne correspond pas à
ma conception de la mise en scène.
Nino
: Mais alors, pourquoi vous avez applaudi ?
Donald
: Pour le personnage principal. Je voudrais lui ressembler,
moi... S’amuser, rater sa vie, devenir un gigolo... et réussir
sa mort !
Nino : Mais comment sait-on
qu’on a réussi sa mort ? "
| |
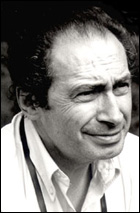 |
|
|
Et Simon de la Brosse sort
du champ de la caméra dans un éclat de rire,
en prenant son partenaire par l’épaule dans un élan
amical. Thierry Frémont était certainement loin
de se douter de quoi que ce soit. Les années 80 finissaient
leur décade et on ne pensait pas aux années
d’incertitude, les années 90. Dans le même film,
Sophie Minet, une actrice jouant une comédienne, détient
une phrase clef dans les textes qu’elle doit apprendre. C’est
une phrase qui ponctue une conversation autour du suicide
des acteurs, avec Ann-Gisel Glass et Thierry Frémont,
dans les derniers instants du film : " De
toute façon, on ne se tue pas pour mourir, on se tue
pour exister ". Cette phrase dévoile,
de manière étrangement prophétique, la
souffrance de l’enfance difficile qu’a vécue Simon
de la Brosse : dans l’ultime élan, on se tue avant
tout pour exprimer quelque chose, et il s’agit ici d’un désespoir.
Sa dernière parole, faite de murmure, cache toutes
les autres, notamment celles qu’il a écrites entre
deux prises ou deux tournages. Car il n’était pas seulement
un jeune acteur voué au succès, il était
et demeure avant tout un poète dans l’exercice de sa
fonction, l’art. Ses textes et ses toiles, même s’ils
ne sont pas encore connus, témoignent pour lui. Ils
ont l’avantage d’exister et de prouver que le silence n’est
pas forcément une langue d’oubli. Chose étrange,
ce qu’il a laissé sur les pages ou les toiles est aussi
parlant, voire plus frappant que l’image qu’il a léguée
au cinéma.
Dans un documentaire de
Jean Henri Meunier et Willy Pierre, Simon de la Brosse,
Paris Amsterdam (collection intitulée Libertés
d’acteurs ), quelques jours avec lui nous sont montrés
par le biais de son visage intime et profond. La date :
25 avril 1989. On entend une voix de petite fille lui demander :
" Simon, qu’est-ce que c’est un acteur ? " ;
et lui de répondre : " Qu’est-ce
que c’est qu’un acteur ? Etre un acteur, c’est être
poète d’abord, avoir un regard, regarder, écout-er,
sentir, agir. Agir sur le néant, sur le chaos, les
pieds nus [...]. ".
|