|
Dani Kouyaté regrette
qu’il n’existe aucune école pour les comédiens
en Afrique francophone, mais reconnaît que ce n’est
pas économiquement viable. " Pour créer
une école, il faut avoir des sous. Si ceux qui vont
s’inscrire ne peuvent pas payer des frais de scolarité,
l’école ne peut pas fonctionner. "
Alors les Africains doivent
apprendre sur le tas. "C’est en forgeant qu’on devient
forgeron", rappelle Kouyaté avec un sourire. Mais
avec seulement un film tous les deux ans, il faut vraiment
se détacher du lot pour tenter de figurer dans le maximum
de productions.
Contrairement au cinéma
occidental où la distribution des rôles est l’une
des premières préoccupations dans l’étude
d’un projet de film, pour des considérations de marketing
notamment, en Afrique c’est l’une des dernières priorités,
tout simplement parce que le culte de la star n’a aucune mesure
avec celui qui s’est développé aux Etats-Unis,
et parce que les producteurs n’ont pas les moyens d’offrir
des cachets à des acteurs fétiches.
Quelquefois,
on ne sait pas jusqu’à la semaine précédant
le tournage, qui figurera dans le film ", lance
Kouyaté aux spectateurs réunis dans une salle
d’art et d’essai du 10e arrondissement de Paris. " A
la limite, si un acteur refuse un prix qu’on lui offre, il
sera remplacé par un autre indistinctement, parce qu’on
ne peut pas offrir davantage ", dit Kouyaté,
tout en décriant le manque de professionnalisme et
de respect des cinéastes africains pour le travail
de l’acteur.
"Sur la plupart des tournages,
précise-t-il, les acteurs et les techniciens acceptent
" amicalement " la modeste paye offerte,
davantage par passion du cinéma et amour du projet
que pour la rétribution financière. Ce qui donne
lieu par ailleurs à des ambiances de travail plus agréables
sur le plateau. "
Outre la distribution des
rôles, le circuit de distribution des films africains
pose également un problème majeur. " On
vend le cinéma comme des bananes ou du cacao et il
y a très peu de place pour des films à risque
comme le mien. Bien sûr, c’est le cas partout ailleurs
dans le monde pour les films d’auteur. Le problème
pour nous, c’est que même sur notre propre terrain,
nous n’avons pas de marché, et aucune infrastructure."
Le Burkina Faso, par exemple,
est le seul pays de l’Afrique de l’Ouest qui possède
une billetterie pour faire le décompte des entrées.
Le nombre d’entrées importe peu aux exploitants puisque
la grande majorité des films présentés
sont des grosses productions américaines qui ont déjà
eu une large distribution dans les pays du Nord.
" Rambo, quand
il arrive chez nous, il est déjà fatigué
! ", lance Kouyaté avec humour. " Pour
ne pas perdre d’argent, explique-t-il, il faudrait
être distribué dans toute la sous-région
sub-saharienne parce que les prix d’entrée sont très
faibles (10 francs CFA pour les meilleures places et seulement
1,5 franc CFA dans les salles populaires). Or je demande plus
cher à l’exploitant que Rambo! "
Son ton devient plus amer
lorsqu’il constate la situation de concurrence déloyale
à laquelle lui et ses pairs africains sont constamment
confrontés : "Nos films sont des produits
absurdes d’un point de vue commercial. Alors le Grand
prix du jury du FESPACO c’est agréable, mais ça
ne fait pas avancer le schmilblick, surtout quand on voit
que des grands réalisateurs africains comme Ben Ousmane
ou Idrissa Ouédraogo ont encore du mal à collecter
de l’argent pour faire leurs films. "
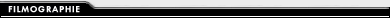 |
|
2001
Sia, le rêve du python (Long métrage,
96 min)
1998
À nous la vie (Série TV, Béta
SP, 12 épisodes de 26 min)
1995
Keïta ! L'héritage du griot (Long
métrage de fiction, 94 min)
1993
Les Larmes sacrées du crocodile (Court
métrage, Béta, 10 min)
1991Tobbere
Kossam (Court métrage, 26 min)
1989
Bilakoro (Court métrage, 15 min)
|
|
|