|
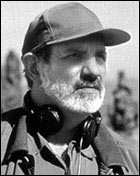 |
|
|
|
Même si l’on décèle
une prédilection particulière de la part de
De Palma pour les films policiers ou les films fantastiques,
il faut donc surtout souligner son désir de travailler
les différents genres de l’intérieur, à
la manière de Kubrick, la différence majeure
dans cette approche des genres résidant probablement,
pour les deux réalisateurs, dans le matériau
à l’origine de leurs films respectifs. On sait que
la quasi-totalité des films du réalisateur de
Eyes Wide Shut était basée sur des romans
ou des nouvelles, qui n’étaient d’ailleurs pas toujours
portés au pinacle par la critique littéraire.
Brian de Palma, quant à lui, s’appuie avant tout sur
ses références cinématographiques, adaptant
pour le grand écran des séries comme Les
Incorruptibles ou Mission Impossible en essayant
à la fois de condenser et de dépasser les qualités
propres à ces produits télévisuels, ou
transposant dans un contexte différent l’intrigue de
chefs d’œuvre passés dans le patrimoine cinématographique,
à l’occasion de Phantom of the Paradise, nouvelle
adaptation étonnante du Fantôme de l’Opéra,
ou encore de Blow Out et de Scarface, qui revisitaient
avec inventivité les films de Michelangelo Antonioni
et Howard Hawks. Cette tendance à la transformation
de films existants est à l’origine d’un certain malentendu
à l’égard de De Palma, puisqu’il est aisé
de constater que son travail va bien au-delà des simples
remakes hollywoodiens, dont l’unique vocation est d’insuffler
une apparente modernité dans des scénarios anciens
afin de permettre à des films de trouver un nouveau
public (qui ne connaît généralement pas
l’œuvre originale…)
Puisqu’il aime comme Kubrick
se confronter aux genres, il n’est finalement pas si étonnant
que Brian de Palma ait accepté de s’attaquer à
un univers cinématographique qui lui était inconnu :
la science fiction et donc, à l’intérieur de
celle-ci, le Space-Opéra. A l’instar de Mission
Impossible, il faut toutefois préciser que Mission
to Mars est un film de commande, sur lequel de Palma est
de plus intervenu relativement tard, puisque les préparatifs
du tournage étaient quasiment terminés lorsque
le producteur a fait appel à ses services. Ceci peut
expliquer certains choix radicaux sur lesquels nous allons
revenir et qui font que l’on ne peut effectivement pas assister
à la projection du film sans songer à 2001 sans
toutefois que cela soit finalement toujours péjoratif,
de la même façon que l’on ne peut s’empêcher
de penser à Antonioni à la vision de Blow
Out : plutôt que de biaiser en essayant d’éviter
totalement l’obstacle constitué par 2001, De
Palma a préféré conserver son point de
vue habituel sur le processus de création en réalisant
une variation sur le thème de la rencontre d’une intelligence
extra-terrestre.
| |
 |
|
|
Il faut cependant reconnaître
que le pari n’est pas complètement réussi :
avouons que, au-delà de la gageure technique que constitue
le plan séquence initial, procédé cher
à De Palma et qui fait la joie des amateurs de prouesse
de mise en scène (on se souvient que la campagne de
lancement de Snake Eyes était souvent orchestrée
autour de son plan séquence d’ouverture qui durait
près d’un quart d’heure), voir dans le prologue Tim
Robbins brandir une saucisse en plein barbecue n’a pas la
même puissance symbolique et poétique que de
voir un singe brandir un os en plein désert pour en
faire un outil, premier signe d’une intelligence humaine…
Plaisanterie mise à part, cette tendance à la
virtuosité technique plombe lourdement un grand nombre
de séquences où la mise en scène est
non seulement visible nettement mais aussi revendiquée
comme telle, masquant par conséquent l’intrigue. Ainsi,
puisqu’il a choisi (et il fallait l’oser !) de réaliser
une séquence durant laquelle nous découvrons
l’intérieur d’un module spatial circulaire en rotation
(ceci afin de supprimer artificiellement les effets de l’apesanteur)
par le point de vue d’un personnage, il se heurte fatalement
à une des séquences les plus célèbres
du film de Kubrick, qui avait déjà à
l’époque suscité un grand nombre de gloses techniques.
Dès lors, pour tenter de faire oublier 2001,
De Palma joue la carte de la surenchère en empilant
les difficultés de mise en scène d’un tel plan :
loin d’isoler son personnage, il multiplie dans chaque coin
de l’image de petites niches où se logent d’autres
cosmonautes évoluant dans des dimensions différentes,
le comble étant atteint lorsque notre guide décide
sans la moindre raison d’ôter sa veste afin que tout
un chacun puisse bien vérifier que l’acteur n’est pas
le moins du monde à l’envers, la veste pendant mollement
vers le sol comme tout vêtement qui se respecte.
D’autres procédés sont calqués sans la
moindre vergogne sur L’Odyssée de l’Espace,
à commencer par le décor dans lequel finissent
par entrer nos courageux explorateurs et dont la blancheur
immaculée ne peut que rappeler les pièces au
carrelage d’un blanc pur où atterrissait Dave Bowman,
le héros de 2001, au terme de son voyage initiatique
(bien sûr, hormis le fait que le décor est ici
géantissime…)
|