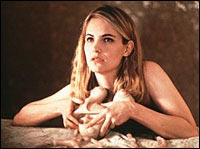 |
|
|
|
D’ailleurs,
un autre personnage, joué par la même actrice,
apparaît plus tard dans Interzone. Ce qui prouve
que le corps ne disparaît pas juste parce que la mort
l’a désintégré. Le souvenir du corps
de sa femme reste planté dans son cerveau. Lee s’invente
Joan en Interzone. C’est la figure du double qui est
exprimée dans le personnage de Joan. Cette même
idée du double qu’on trouve dans Lost Highway
de David Lynch, et dans Vertigo, d’Alfred Hitchcock,
notamment. En Interzone, tout semble possible. Témoin,
au début du film, cet écriteau en lettres blanches
: "Rien n’est vrai, tout est permis". Interzone
est une espèce de non-lieu, un univers chaotique, où
la paranoïa se plaît à semer des germes
destructeurs, et où la réalité n’a de
forme que par la vision des habitants. A cet effet, il est
indispensable de souligner que Burroughs croyait en la magie,
et aux formes paranoïaques du corps. Interzone
ressemble, pour ma part, à un laboratoire. Un laboratoire
où on ausculte les corps, où on les rend difformes,
où on peut les manipuler à l’infini. En Interzone,
des personnages se rencontrent. Chacun d’eux développe
au fond de leur être un fantasme particulier. L’inconscience
se mêle indiscutablement à leur conscience, et
leur activité sexuelle devient un événement
de l’esprit (pour exemple, la liaison tragique par la chair
de Cloquet et de Kiki). Le corps est pris alors entre le réel
et l’étrange, l’hallucination et la vérité.
L’âme se détache de la chair. L’âme reçoit
les mots (les mots s’inscrivent sur la machine, puis entrent
dans la tête de Lee pour en sortir par la chair), et
la chair matérialise les images. Ainsi, tout s’articule
autour de Lee. Son corps s’invente les personnages proches
de son intérieur et il est, peu à peu, contaminé
par son propre environnement, projection de lui -même.
D’après
Nietzsche, qui prône la volonté de puissance
(thème abordé dans Crash), "La
vie est une maladie". Bien sûr, mais cela dépend
de quelle maladie il s’agit. Il faut savoir de quelle façon
la vie est contaminée. Est-ce que le corps se sent
happé par une "autre réalité"
(réalité suicidaire), une réalité
dans laquelle il souhaite évoluer ? Pour William Burroughs,
l’auteur favori de Cronenberg, la réalité n’existe
pas. C’est juste ce que nos yeux perçoivent. Certains
peuvent observer une réalité sans artifice,
et psychologiquement fluide, d’autres, au contraire, verront
une réalité étrange, dénuée
de sens, une réalité où les monstres
et les êtres humains se mêlent sans aucune appréhension.
Une réalité où de nombreuses expériences
un peu bizarres transforment les corps (en les sacrifiant
même). Cet aphorisme de Burroughs inscrit au début
du film justifie ce propos : "Arnaqueurs du monde,
il y a une Marque que vous n’égalerez jamais : la Marque
intérieure." Ainsi, c’est l’intérieur
qui choisit la substance que le corps doit revêtir.
L’intérieur qui s’invente les images et les
mots. Tout vient de l’intérieur : de la chair.
Tout exulte du corps, de ce que les personnages s’infligent
comme hallucinations. Des hallucinations qui les trompent
et qui créent une certaine réalité.
| |
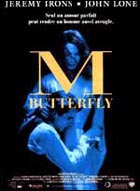 |
|
|
Avant
de réaliser M.Butterfly (93), Cronenberg suggéra
dans le scénario de privilégier les relations
intimes des deux protagonistes plutôt que la dimension
politique de leur aventure. Faire un film où le corps,
influencé par un romantisme puissant, puisant sa source
dans l’amour absolu, ne se dérobe pas face aux illusions
mais au contraire, s’y livre pleinement. Les fins politiques
ne sont qu’un infime détail, et d’ailleurs Gallimard,
joué par Jeremy Irons, fermera les yeux sur celles-ci,
absorbé tout à fait par ce qui est venu se cacher
en lui, qui l’a transformé. Ce film nous révèle
qu’un homme ne peut jamais connaître réellement
ses semblables. Gallimard, comptable à l’ambassade
de France de Beijing, fasciné par le romantisme
et le mystère de la Chine traditionnelle, crée
une femme à partir de ses propres besoins et de sa
propre imagination : son fantasme. Il tombe amoureux d’une
vision. Son corps prend alors un tout autre état. "Il"
se révèle. Et peu importe que M.Butterfly soit
un homme ou une femme. D’ailleurs, le visage de celui ou celle-ci
est double. Souvent, et cela est rendu de manière admirable,
on devine sur le visage de Butterfly les traits féminins
d’un homme. Gallimard est attiré par Butterfly, non
parce qu’il désire Butterfly dans la réalité
brute, mais parce que son corps (et l’intérieur
de ce corps) prend une autre fonction que la singularité
et sent au fond de lui les fantasmes qui lui conviendrait
pleinement. Ce qui rend la relation extrêmement excitante.
|