 |
|
|
|
Quand Maurice Garrel
revient dans quelques plans de Sauvage innocence, alors
que sa mort fictive, dans le même rôle (le père
de l’artiste), scellait Le Cœur fantôme en
1996, on en repasse de nouveau par la comparaison avec Moretti
pour avancer ceci : la mort du père une question
du / au passé (il est déjà un spectre,
toujours un ange qui passe) pour Garrel quand, pour Moretti,
la mort de la mère dans La Messa e finita
en 1987 ou du fils, l’année dernière, est une
question que l’on se posera demain. Ce passé qui revient
dans le présent des plans des derniers films du cinéaste
depuis dix ans est ce principe de dévoration,
ce qui mine ces plans-mêmes (on pense ainsi à
Faulkner). La neurasthénie affectant le cinéma
garrelien et ses corps découle directement de cet état
de fait-là. " On est toujours fatigué
de quelque chose " disait Gilles Deleuze, et il
s’agit toujours d’une fatigue du présent supportant
un poids de passé qui ne passe pour ainsi dire jamais.
Tel Atlas, le plan garrelien est le support fragile où
se lit le dépôt de cette action (les tics faciaux
de Maurice Garrel, les taches de vieillesse de Michel Subor,
celles de vin sur le visage de l’assistant réalisateur
Marco), de cette pression invisible mais physiquement ressentie,
par exemple lorsque, de manière assez antonionienne
(l’ancien petit ami photographe de Lucie, Augustin, parle
de partir en Patagonie comme un personnage de Deserto rosso
en 1964), le plan devient flou à la suite de la sortie
du cadre par un personnage en continuant de durer un peu plus
que ce qu’il devrait. Flou du plan qui rend aveugles le cinéaste
et le spectateur, comme une maladie de la perception qui est
celle de ne plus voir un être qui puisse à lui
tout seul redonner au monde sa visibilité, sa viabilité.
Durée du plan qui rend malheureux quand le monde continue
sans nous, même s’il n’est plus vu de nous, sans se
soucier de nos passages, monde définitivement plus
raccord avec notre regard, avec notre présence.
| |
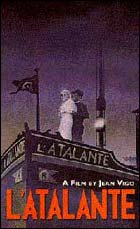 |
|
|
Le cinéma garrelien
semble n’en avoir jamais fini avec ses démons qui puisent
leur immortelle actualité dans le présent des
vivants (ce sujet brûlant qu’est la drogue auquel se
confronte directement le cinéaste en montrant la chaîne
mortifère qui se construit autour de l’héroïne).
Le plan garrelien figure alors le lieu d’une interface par
laquelle coexistent les morts et les vivants, d’une interzone
où luttent âprement ceux-ci et ceux-là,
quand les premiers prennent possession des seconds (le rêve
de François – son interprète Mehdi Belhaj Kacem
ressemble par ailleurs davantage à Eustache qu’à
Garrel lui-même – où Carole, son ex-compagne
et top-model décédée inspirée
par Nico, le harcèle jusqu’à vampiriser dans
le réel l’actrice Lucie censée incarner son
personnage dans la fiction que tourne François). On
n’est alors pas si éloigné du Styx traversé
par Charon (ou de son appropriation japonaise lors d’une magnifique
scène des Contes de la Lune vague après la
pluie de Mizoguchi en 1953), quand Garrel est ce passeur
naviguant le long de ses nappes filmiques (la Seine dans L’Enfant
secret , la Méditerranée dans Le
Vent de la nuit, les canaux hollandais ici), amenant son
spectateur comme ses acteurs (et ses actrices surtout, les
belles plantes qui ressemblent au départ aux modèles
lumineux de Vermeer, Ingres ou Renoir pour finir, vidées,
noircies, telles les femmes des tableaux de Redon et de Munsch,
cadavres en sursis comme chez Manet), selon des mouvements
natatoires privilégiés, en " voyage
dans le jardin des morts ", comme l’indiquait un
de ses films datant de 1978. Les travellings, combinés
avec ces plans de vélo à Amsterdam pas amnésiques
de la mort de Nico tombée de bicyclette, ont retenu
la leçon de L’Atalante de Vigo en 1934 avec
son couple séparé et trempé dans la sueur
de nuits coupables et agitées et ce camelot en déséquilibre
sur son vélo au bord de la Seine, ainsi que de toute
l’école de l’eau française des années
20 et 30, L’Herbier, Epstein, Delluc ou Renoir.
Le lit du fleuve, Le Lit de la Vierge (1972), le lit
du plan : le cinéaste prend cette image à
bras le corps comme le transport, la métaphore de la
manière par laquelle il envisage ses plans, ses images.
Image dérivée d’André Bazin (le moulage
et la nature ontologique du réalisme photographique),
image empruntée par Serge Daney, le plan-lit garrelien
a compris ceci : si les corps qui l’empruntent peuvent
être vierges (de cinéma : Mehdi Belhaj Kacem
qui par son non-professionnalisme – l’ami Léos Carax
a un moment été pressenti – met à distance
son personnage comme s’il le regardait et en était
le premier étonné : cette interstice entre
l’acteur et son rôle laisse la possibilité à
l’histoire même de Garrel comme à la conscience
du spectateur de s’infiltrer au cœur de la machine à
fictions qu’est le film ; mais aussi Julia Faure et le
personnage de Lucie que joue celle-ci), le plan-lit, lui,
ne l’est jamais (voir l’amour de Garrel pour les scènes
de lit, toujours pudiques et issues du cinéma de la
Nouvelle Vague, notamment celui de Godard).
|