 |
|
|
|
Le premier plan du
film articule ainsi en toute simplicité une diversité
de sens qui, par leur entrecroisement (le plan-lit comme œuvre
de couture, de broderie subtile), signe la pluralité
et la coexistence des différents niveaux, non de lectures
(le cinéaste demeure inébranlablement dans la
modernité) mais de réalités et de temporalités.
Ce plan en trois quart plongée sur une voie de chemin
de fer en banlieue parisienne tient ensemble et entrelace
les rails des travellings de cinéma, ceux qui permirent
aux trains de déportés de finir à Auschwitz
(le récit de la Hongroise Zsazsa, la copine en voie
de zombification du producteur Chas interprété
avec panache par Michel Subor, au sujet de son grand-père),
enfin les rails d’héroïne que sniffent Zsazsa,
puis Lucie, puis son ancien petit ami Augustin, peut-être
déjà Chas.
En tout cas, c’est lui qui fournit dans les grandes largesses
les doses de mort et, par la bague que Jaja met au doigt de
Lucie, lance cette ronde infernale qui voit François
manipuler Lucie, Chas manipuler ce dernier ainsi que Lucie
et tout l’entourage du tournage, tels des cercles concentriques
épuisant la vie jusqu’à ce " Death
Camp " de John Cale dont les stridences accompagnent
le plan final, noir comme un tombeau. Pour Garrel, le cinéma
est à l’intersection : des petits et des grands
récits, devant et derrière la caméra,
du réel et de l’imaginaire, du rêve et de la
réalité, du présent et du passé,
de la vie et de la mort. D’où la présence récurrente
et métonymique dans l’œuvre entière de bébés
ou d’enfants, qui rappelle à quel point son cinéma
est gros (c’est-à-dire enceint d’images, d’affects
et de récits), à quel point le grain de ses
plans (le 16 mm. gonflé en 35 a souvent été,
dans la pauvreté qui a longtemps accompagné
Garrel, la règle du jeu) dans la visibilité
de son mouvement manifeste la réalité de cette
grossesse (cf. la citation des Cahiers du Cinéma
n°204 mentionnée plus haut), à quel point la
réalité passée au filtre, au tamis de
ce réalisme cinématographique si particulier
dans la stylisation en est comme organiquement affectée.
| |
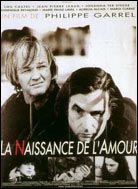 |
|
|
L’intersection, c’est
aussi l’aiguille pleine d’héroïne enfoncée
dans la veine du drogué qui désire avoir son
" flash ", une image du réel que
Garrel applique directement à son cinéma (la
piqûre qu’effectue la caméra sur un morceau du
réel addict, à l’instar de Lucie, à
ces prises de possession, pendant que le cinéaste François
voit le soir le résultat des prises, des " rushes "
de la journée). C’est pour cette raison qu’il faut
absolument associer des artistes tels Garrel et Ferrara sur
l’idée confessée sur le registre de l’intime
(réalité présente pour Ferrara, passée
pour Garrel qui n’a pas oublié " Opium "
de Cocteau ou les livres de Michaux) que la pratique du cinéma
relève d’un état de dépendance quasi
physiologique (dépendance issue de cet art envers le
réel), avec la dose sévère de cruauté
morbide que ce contrat implique. Mais c’est aussi le manque
amoureux d’Augustin envers Lucie, prostré comme s’il
lui manquait sa dose, le manque affectif de Zsazsa qui, littéralement,
se fait un shoot quand elle raconte à Lucie
l’histoire de sa vie désolée (d’ailleurs, par
un curieux paradoxe d’un film qui, pour notre joie, en compte
beaucoup, c’est Zsazsa qui nous fait davantage penser à
Nico que Lucie ou le personnage de Marie-thérèse
qu’elle devra jouer au cinéma). En contrechamp positif,
c’est le fils de Carole que rencontre François en tout
début de film, tout jeune père qui prépare
attentivement, et avec le même soin que Zsazsa et ses
doses, le lait chaud de son bébé.
Le cinéma pompe le réel (voir cette femme de
ménage passant l’aspirateur dans le bureau d’un producteur),
vampirise la vie et le résultat de cette vampirisation,
de cette ponction, se lit sur ce grand lit vertical, lit blanc
d’hôpital, qu’est le grand écran. Accompagnant
les corps blafards et les mines légèrement comateuses
des personnages, le noir et blanc garrelien (comme celui de
The Addiction de Ferrara au titre largement explicite),
entre des surexpositions lumineuses qui semblent consumer
la matière vivante du plan jusqu’à l’extase
de l’écran blanc final et des fondus au noir qui, souvent,
on ne sait plus très bien, ne sont peut-être
pas dus à des effets de caméra et de diaphragme
mais à des chutes certaines de la lumière naturelle
renvoyant dans le champ de l’antimatière ce qui vivait
dans le plan, possède une force de stylisation (Raoul
Coutard à la photographie depuis La Naissance de
l’amour en 1993, excepté pour Le Vent de la
nuit : clin d’œil amical, le chef opérateur
du film que tourne François se nomme Raoul Maître)
qui puise son inspiration quelque part entre celui du Paris
fantomatique et raréfié de Pickpocket
de Bresson en 1959 et celui plus prononcé et inquiétant,
mais comme intériorisé par Coutard, que Karl
Freund réalisait pour Murnau (la seconde heure de Sauvage
innocence et sa partie consacrée au tournage d’un
film provisoirement intitulé … Sauvage innocence).
|