 |
|
|
|
Ce peut être
aussi une lumière semblable à celle de Dreyer
qui accompagne un couple (encore) amoureux quand il pénètre
dans un plan à l’instar de celui de Dies Irae en
1943, ou de Renoir lorsqu’elle semble irradier d’un personnage
apaisé en plein soleil d’après-midi, pendant
une partie de campagne relaxante lors d’un arrêt de
tournage. De Bresson, Garrel a gardé la matérialité
des portes, des escaliers et des murs qui découpent
l’espace et écrasent les individus paraissant toujours
fragilisés par les lieux qu’ils traversent, malgré
l’obstination de leurs desseins souvent inavouables (les marches
de François et de Lucie, cette façon si caractéristique
chez Garrel de parler un ton en dessous, comme pour mieux
se faire entendre jusqu’au souffle vital des acteurs eux-mêmes
et qui se confond avec le murmure du vent dans les branches
des arbres). En rapport à Dreyer, il opère à
l’envers un miracle semblable à celui de la lévitation
de Johannès de Ordet en 1954, opération
de magie noire et de sorcellerie chez Garrel quand elle était
blanche chez le cinéaste danois puisque Chas apparaît
dans un plan, assis au bord d’une table écrasée
par le peu de profondeur de champ et surplombant François,
comme un mauvais génie flottant dans l’air. De Murnau,
il reprend enfin la puissance de trouble inhérent au
cinéma en tant qu’il est une machine de vampirisation
du réel. Et François, malgré son
air chétif et angélique, ne ressemble-t-il pas,
lorsqu'il est filmé de trois quart dos, à Nosferatu,
en quête d’une jeune fille dont la chair et le sang
frais alimenteront ses désirs d’exorcisme cinématographique,
afin de se débarrasser une bonne fois pour toutes du
cadavre encombrant de Carole qui hante ses nuits tourmentées
et dont il croit porter la responsabilité, alors qu’il
sera coupable en toute inconscience de la mort de Lucie ?
Ce que filme Garrel avec la distance amusée de celui
qui déjoue les clichés accolés à
son cinéma, c’est l’innocence de la perte d’innocence :
ce n’est plus l’innocence qui est innocente mais sa perte
elle-même et celle de ses agents, en toute connaissance
de cause (le personnage de Chas, dragon au souffle rauque,
être de soufre et de cendre qui se confond avec son
interprète Subor en faisant de son artificielle posture
la seule vérité, la seule réalité
aux dépens de toutes les autres) ou feignant bêtement
de l’ignorer (l’inconscience mortelle de François),
sans même parler de Lucie qui la perd fatalement en
cours de film en ne s’en rendant jamais compte. Voilà
cette sauvagerie dont parle le titre et que le film sublime
dans la plus extrême douceur (le cinéma garrelien
est par essence féminin), sans rien dénier de
cette violence.
| |
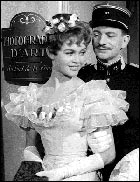 |
|
|
A côté
des trois temporalités-réalités, toutes
coexistantes, que le film déploie (l’histoire de Garrel
avec Nico, celle de François dans le souvenir de Carole,
celle de François avec Lucie incarnant pour son film
Marie-Thérèse dont le personnage est largement
inspiré de Carole), le cinéaste en repasse par
le récit du " Portrait ovale "
de Poe (" C’est la vieille histoire – que Godard
a reprise pour Vivre sa vie - du modèle qui
meurt quand le tableau est fini. Le modèle valait mieux,
sans doute, que le tableau ", Philippe Garrel à
Thomas Lescure, Une caméra à la place du
cœur, Admiranda / Institut de l’Image, 1992, p.119), en
ce qui concerne surtout la seconde partie et le tournage proprement
dit (le dessin de Chas représentant Lucie, mais déjà
dans Topaze de Hitchcock en 1969, Michel Subor en crayonnait
un autre tout aussi mortel). C’est surtout le mythe de Faust
(" Le cinéma me fait penser au mythe de Faust.
Si on veut imiter la perfection de la nature, c’est perdu
d’avance (…) Le cinéma ne nous rend pas les gens dont
on parle ", Philippe Garrel, entretien avec les
Cahiers du Cinéma n°447, p.34), mythe littéraire
popularisé mondialement par Goethe et cristallisé
au cinéma par l’adaptation de Murnau dans son film
éponyme datant de 1926 et par René Clair dans
La Beauté du Diable en 1950 (on voit d’ailleurs
une affiche des Grandes Manœuvres du même René
Clair dans le bureau du premier producteur que rencontre François)
qui irrigue entièrement le film de Garrel.
Et il faut voir les grandes manœuvres de François,
habité par un fantasme nécrophile à la
hauteur de celui du héros de Vertigo de Hitchcock,
qui est de ressusciter une morte pour mieux l’assassiner de
nouveau et définitivement, écrivant des pages
et des pages, noircissant des feuilles comme s’il s’abreuvait
du sang (ses taches sur le dos) de Lucie. Si Mehdi Belhaj
Kacem rappelle par sa gracile beauté l’éternel
jeune premier qu’était Gérard Philippe et qui
tenait le rôle de Faust dans le film de Clair, Subor
comme double méphistophélique et expansif (Chas
a aussi connu Carole) de François, personnage plus
malingre, lâche et faible que lui, fait revenir dans
nos mémoires par sa grandiloquence et son sens du théâtre
et de la déclamation les fantômes d’Emil Jannings
du film de Murnau et de Michel Simon du film de Clair.
|