 |
|
|
|
Ainsi, Garrel figure
les deux médianes (Poe, Faust) traversant le triangle
romanesque qu’il trace à partir de sa vie réelle
pour que celle-ci, par un savant jeu de miroirs (et on en
voit beaucoup dans le film, Chas apparaissant même de
l’un d’entre eux comme reflet fantastique de François),
un palais des glaces de l’imaginaire et de la fiction, des
réminiscences cinéphiliques et des récits
mythiques, s’ouvre au labyrinthe de son devenir-roman. Notons
qu’il n’y a aucun maniérisme chez le cinéaste
quand il appelle à lui sans rien forcer, attire plutôt
qu’il ne cite à l’envers un plan de Way down east
(1920) de Griffith – un chat ouvrant les yeux quand il les
fermait chez Griffith – parce que, comme chez Nicholas Ray,
il s’agit bien ici de glace, de la banquise des sentiments
et du cinéma quand il fige ceux-ci dans du celluloïd,
du nitrate d’argent.
N’excluant ni l’humour (la composition " à
l’ancienne " de Subor, le traitement masochiste
du personnage de François), ni l’aventure (l’escale
en Italie pour récupérer de la drogue dont la
vente servira à financer un film fait contre les drogues :
c’est comme si Garrel regardait du côté du Beauvois
de N’oublie pas que tu vas mourir auquel il a participé
en réalisant un plan, quand ce film lorgnait explicitement
du côté de son cinéma à lui), ni
le sordide (l’overdose finale qui allonge la liste des morts
fermant les films récents de Garrel : J’entends
plus la guitare et Marianne, Le Cœur fantôme
et le père de Philippe, Le Vent de la nuit
avec le suicide du personnage de Daniel Duval) ou l’obscénité
(de l’urine de J’entends plus la guitare aux
règles tachant le lit de La Naissance de l’amour,
en passant par Lucie vomissant ici : avec les canaux
hollandais et les trafics de Chas en contrepoint, le motif
de la circulation est évidemment l’une des clés
maîtresses du film), le dense récit que met en
place Garrel montre les ultimes prolongements d’une gueule
de bois (cette sarabande masquée dansant sur un rock
de Them que filme François à Amsterdam) dont
les enfants de mai 68 ne se sont toujours pas remis (la pauvreté
et la solitude de François) ou alors trop bien (Chas
en aristocrate cynique dont l’aventureuse existence est uniquement
motivée par l’appât du gain), une fin de partie
qui fait encore des victimes (les clichés sur la révolution
énoncés par le personnage de Xavier Beauvois
dans Le Vent de la nuit, sur le monde du cinéma
par Lucie qui lui seront fatales) et qui ne produit plus rien
d’une quelconque transmission (Le Vent de la nuit),
ou alors que des trahisons (Chas avec François, ces
derniers avec Lucie).
| |
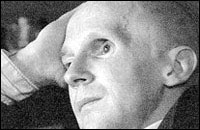 |
|
|
La plus grande ironie
est de vouloir faire un film contre l’héroïne
(avec le glissement sémantique – c’est un jeu de mot
/ de maux que l’on avait déjà dans J’entends
plus la guitare – que cela suppose : contre la drogue,
contre celle qui est morte à cause de cela et dont
on ne se remet pas, contre celle enfin qui devra l’incarner
au prix de sa vie) avec l’argent sale du trafic de drogue
que cela rapporte à Chas qui, de plus, inonde le tournage
de ses saloperies. Le pacte de nature faustienne que concluent
François et Chas, le combat contre la drogue se substituant
à celui contre la peste de l’histoire originale (on
remarquera l’emploi intelligent de Mehdi Belhaj Kacem, a priori
contradictoire puisqu’il a au moins vingt ans de moins que
Garrel alors qu’il est censé le représenter
à l’écran, mais c’est parce qu’il figure un
nouvel avatar de Faust, celui qui a vendu son âme au
diable et à l’art pour pouvoir conserver une jeunesse
éternelle), conduit au sacrifice de Lucie (Marguerite
chez Goethe et Murnau) sur l’autel du trafic de drogue, de
sentiments, de la connaissance et de la paix intérieure
que le cinéma devrait procurer à François
alors qu’il n’en est rien, bien au contraire.
|