|
Cette tension latente
sur laquelle s’appuient les deux réalisateurs prend
racine dans un passé soigneusement tenu secret, dont
les réminiscences ectoplasmiques contraignent à
une résurgence inévitable. Chaque film possède
en effet son fantôme dans le placard. Pour L’échine
du diable, c’est la disparition subite d’un des petits
pensionnaires qui fait mystère. Pour Les Autres,
c’est la fuite soudaine des domestiques et le comportement
suspect de la mater familias qui pose le suspense.
La mort règne dans
d’oppressants huis clos domestiques, mais elle sévit
également au dehors. L’échine du diable
se déroule en pleine Guerre d’Espagne, Les Autres
juste après la Première sauterie mondiale. A
l’extérieur, le monde est donc lui aussi rempli de
spectres.
Petit à petit, L’échine
du diable se démarque pourtant du film d’Amenabar.
Une fois la première demi-heure passée, le côté
fantastique s’estompe pour laisser place à une véritable
étude de mœurs, une analyse profonde des rapports humains.
La silhouette translucide d’un fantôme juvénile
apparaît bien dans plusieurs scènes, mais elle
n’est qu’un élément du scénario, partie
intégrante mais non essentielle de la réflexion
du réalisateur. Guillermo del Toro cherche visiblement
à mettre en image une approche thématique plus
complexe qu’une simple variation sur les poltergeists.
Bien sûr, certaines
scènes sont violentes, et à une ou deux reprises,
l’hémoglobine coule à flots. Mais la facture
générale du film reste on ne peut plus classique,
et n’a absolument rien de comparable avec le style des productions
d’épouvante de ces dernières années,
dont Les Autres est l’un des meilleurs représentants.
L’échine du
diable n’est pas un film particulièrement effrayant.
Il ne donne pas vraiment la frousse, juste parfois quelques
frissons. Or un film d’horreur - car c’est bien comme cela
qu’il a été présenté dans un premier
temps - qui ne fait pas peur, c’est un peu comme une comédie
qui ne fait pas rire, un film porno qui ne fait pas bander :
ce n’est pas très réussi. Classer le film de
Guillermo del Toro dans la catégorie des productions
ratées devrait être la suite logique du raisonnement,
mais ce serait passé à côté de
la véritable nature du film.
Certes toute la promotion
de L’échine du diable s’est appuyée sur
son supposé aspect horrifique. Le prix de la critique
obtenu au festival de Gérardmer, rendez-vous annuel
du film fantastique, a été largement mis en
valeur dans la campagne de promotion, en particulier sur l’affiche.
La bande-annonce insistait aussi fortement sur la présence
d’un fantôme pour attirer des spectateurs particulièrement
friands d’histoires de revenants. Injecter L’échine
du diable dans la même veine que Les Autres
facilitait grandement le travail des distributeurs et leur
laissait entrevoir de substantiels bénéfices.
Ah ! Ce satané marketing qui aplanit les reliefs d’une
œuvre pour mieux la ranger dans un tiroir thématique!
L’échine du diable, une vulgaire copie du film
d’Amenabar ? Pas du tout !
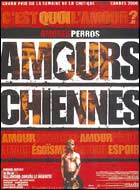 |
|
|
|
Loin de faire du plagiat,
Guillermo del Toro filme d’une manière très
personnelle et très différente de celle mise
en œuvre dans Les Autres, et plus largement dans les
films ibériques actuels. La présence au générique
des frères Almodovar aux postes de producteurs, de
Marisa Paredès (égérie de Don Pedro)
et d’Eduardo Noriega (star en Espagne notamment depuis le
remarquable Ouvre les yeux, le deuxième film
d’Alessandro Amenabar) pouvait placer L’échine du
diable dans la riche lignée du cinéma espagnol
contemporain. Mais cela tient plus de la coïncidence
pratique que d’une réelle volonté artistique.
Au départ, le réalisateur mexicain voulait tourner L’échine
du diable dans son pays natal, comme ce fut le cas de
Cronos. Afin de résoudre des problèmes
de production, il a finalement dû se rabattre sur l’Espagne.
Malgré ce déplacement
géographique, Guillermo del Toro n’abandonne pas tout
à fait son projet initial. Il donne à son film
une véritable couleur sud-américaine, proche
des quelques productions venant du Mexique (comme l’impressionnant
Amours chiennes d’Alejandro Gonzalez Immarritu) ou
d’Argentine (comme le surprenant La Cienaga de
Lucrecia Martel) que les spectateurs français ont pu
découvrir récemment.
|