|
Ferrara, à l’inverse
d’un Kubrick qui n’a jamais cessé de faire les trajets
les plus grands, les plus lointains (la netteté remarquable
chez lui à passer de l’infiniment grand à l’infiniment
petit, à les faire se raccorder, est de nature toute
pascalienne), ne met le nez que dans ce qu’il connaît
et ce qui lui est le plus proche (la came, qui n’est pas synonyme
de rétention ou de repli mais de circulation et d’accélération,
comme figuration symbolique du rapport viscéral, de
dépendance – son grand sujet – qu’il entretient avec
le cinéma).
| |
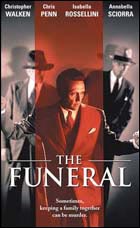 |
|
|
Ainsi est offert à
tous le résultat palpable de ses observations participantes
(à l’instar d’un Fellini, Ferrara, juge et partie de
ce qu’il filme, mouille toujours sa chemise) dans un idéal
de partage vieux comme la chrétienté elle-même
(la distribution lors de la Cène, dont on voit la représentation
dans un des plans du film, du pain – ici ils sont de cocaïne
– par le Christ, avec ce leitmotiv que le cinéaste
prend tout à fait au sérieux : " Ceci
est mon corps, ceci est mon sang ". C’est un autre
miracle christique, celui de transformer le sel en sucre,
que Ferrara reprend en transmuant un feu d’artifice aux particules
colorées dispersées sur l’écran d’une
télévision ainsi que de la neige artificielle
– plus de vraie neige dans le New York de R’ x-mas
– en poudre blanche tout aussi artificielle, la coke.
Insensiblement, deux titres
ferrariens a priori disjoints se raccordent (The Funeral
– Nos Funérailles en français
datant de 1995, Our Christmas en anglais :
il s’agit d’ailleurs des deux seuls films " d’époque "
qu’ait jamais réalisé le cinéaste, le
premier consacré à l’ère de la prohibition
durant les années 30 et le second situé au début
des années 90 juste avant l’accession à la mairie
new-yorkaise de celui qui est considéré aujourd’hui
comme un messie, Rudolf Giuliani), avec les thèmes
communs du commerce et de ses illicites, de la famille en
manque d’un disparu (le frère assassiné de The
Funeral, le mari kidnappé ici) qui fait trou noir,
de la mort et de la résurrection. Autrement dit, la
scène traumatique – mais c’était aussi le viol
de la nonne dans Bad Lieutenant, le meurtre de
The Blackout, les charniers dans The Addiction
– doit opérer de façon rossellinienne, par le
marquage de sa fulgurance inacceptable ou incompréhensible,
l’avènement ou le retour (tel Lazare d’entre les morts)
de la conscience.
 |
|
|
|
Insensiblement avions-nous
écrit plus haut, puisque des percées sanglantes
de Driller Killer en 1979 aux rails de coke des derniers
films, Ferrara a montré ce qui signifie ou doit être
dit par le passage (Murnau, sa référence cinéphilique
absolue) de la plus grande violence à la plus douce
des connivences, des raccords cut aux fondus enchaînés.
Le chemin de la (prise de) connaissance s’effectue sur le
mode du choc quand celui du marché de la drogue prend
les atours de l’aisance, de la facilité, de la fluidité.
Comme chez Dostoïevski (une référence littéraire
tentante pour Ferrara, et Gide aimait à comparer l’écrivain
russe avec Dickens), le montage ferrarien est foudroyant,
plus électrisant que percutant désormais, puisque
du crime au châtiment, de la pureté à
l’abjection (le meurtre final du policier corrompu apparenté
à la décapitation de Saint Jean-Baptiste sur
ordre de Salomon), du bien au mal, du centre (ville) aux extrêmes
(la périphérie, downtown), entre chien
et loup, il n’y a qu’un pas que les fondus enchaînent
sans plus aucun fracas, comme en sourdine. Violence d’autant
plus insidieuse que son assourdissement leurre sur son improbable
absence.
Le pessimisme ferrarien
s’est raffermi, il a cependant gagné en élégance
formelle ce qu’il a perdu en fureur primitive. Ferrara ne
hurle plus, il susurre ce qui fait dans nos vies la plus petite
et irréparable différence (d’où son usage
insistant du gros plan) en opérant le plus tranquillement
du monde la facture moelleuse, cosy, du système
libéral consumériste : acheter l’espace,
le réduire en temporalité malléable à
merci, effacer ainsi toutes les distances et toucher absolument
tout ce qui peut (et doit : c’est un mot d’ordre implicite)
être absorbé par une économie capitaliste
qui ne fonctionne que par l’idée de dépendance
(en ce sens, il n’y pas plus proche de R’x-mas que
Millenium Mambo aujourd’hui). Dépendance vécue
sur le mode approprié de l’engourdissement physique
et de la paralysie morale : non plus un " bio-pouvoir "
(Surveiller et punir de Michel Foucault) de contrôle
des corps mais ce qu’on appellera un " physio-pouvoir "
de contrôle des esprits.
|