 |
|
|
|
Le sociologue Durkheim disait
que " la religion est un système de forces ".
Et le personnage de Maurice Pialat est animé, poussé
même, par une force de l’au-delà. Étymologiquement,
sacré s’oppose à profane. Sacré désigne
ce qui est à la fois séparé et circonscrit
(en latin sancire : délimiter,
entourer, sacraliser et sanctifier), tandis que profane indique
ce qui se trouve devant l’enceinte réservée
(pro-fanum). Il y a donc deux domaines, l’un qui est
réglé de manière transcendante, dangereuse
et capitale, le sacré, interdit parce que fondamental,
et un autre, où l’homme a loisir et liberté
de penser et d’agir à sa guise. La vie est constituée
par l ‘équilibre entre ces deux domaines. Or c’est
justement l’affrontement de ces deux forces que filme Pialat.
L’abbé Donissan est tiraillé entre son corps
et son esprit. Sa volonté d’élever son âme
est contaminée par la lourdeur de son corps qui s’embourbe
dans la terre. Après avoir rencontré Satan,
il se jettera éperdument dans sa mission de lutte contre
le machiavélisme, alors que tout s’oppose à
sa tâche, jusqu’aux images âpres et austères,
cette pesanteur qui écrase les êtres et les paysages,
à l’image de ce ciel plombé qui semble terrasser
l’abbé lorsqu’il se déplacera à travers
champs. Avec des plans très larges, Depardieu, imposant
par son physique, n’est plus qu’un " colosse aux
pieds d’argiles ", qui vacille et trébuche,
dans un cadre dont il est finalement prisonnier. Point d’ouverture
possible vers le hors champ dans ce film, contrairement aux
premiers films de l’auteur. Aucun échappatoire possible
à cette lutte mystique…
Chez Pialat, la transcendance
a le visage d’une quête claire-obscure et brutale, entre
Bien et Mal, foi et doute. S’opposant au vouloir délibéré,
qui seul est vraiment nôtre, la tentation de Donissan
paraît d’abord extérieure et étrangère,
sous la forme du maquignon. Aussi l’attribue-t-on, comme Adam
dans la Genèse, au Tentateur. Mais, même lorsqu’elle
vient du dehors, elle ne prend racine que parce qu’elle trouve
au-dedans un terrain favorable et qu’elle répond à
un désir inconscient. Le maquignon lui dit d’ailleurs
" Vous me portez tous dans votre chair. "
Donissan s’inflige des pratiques ascétiques pour se
préserver de la tentation, mais en vain. C’est donc
Donissan qui est pour lui-même son propre serpent. En
ce sens, la tentation est aussi intérieure et représente
une difficulté plus grande à rester dans la
ligne du Bien, et par-là constitue une occasion de
mérite. L’homme, à partir de sa mort, a développé
le sacré de l’au-delà, qu’il s’agisse d’une
compensation, d’une sublimation ou d’une délivrance.
Il n’est peut-être pas insensé de croire que
Donissan a atteint ses trois " états de grâce ".
| |
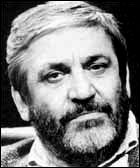 |
|
|
Ainsi pour Maurice Pialat,
le sacré engendre le doute chez Donissan face au pouvoir
absolu de Dieu. L’auteur jubile donc à mettre en scène
des créatures foudroyées par l’Esprit qui travaillent
en eux. La perversité de Pialat est de nous montrer
des êtres qui, au lieu de transmuer leur incertitude
en croyance, font l’inverse. Et c’est justement contre cela
que lutte Donissan qui garde espoir jusqu’au bout. Pour montrer
cette espérance, l’auteur fait évoluer son personnage
dans un espace où tout est possible : le Diable
se montre à Donissan, un enfant est ressuscité…
Pourtant, ces deux scènes peuvent être interprétées
différemment, puisque l’homme qui relève Donissan
n’a vu qu’un maquignon là où l’abbé a
vu le Diable. La scène de résurrection n’existe,
que parce que Donissan y croit et l’espère plus que
tout. L’enfant lui semble lourd à porter, puisqu’il
offre sa vie à l’enfant, en échange de son salut.
A travers l’enfant, c’est donc lui qu’il porte à Dieu.
Le sacré s'enracine donc dans le sacrifice, la mise
à mort. Et c’est parce qu’il croit en ce miracle que
Donissan est sauvé. Ainsi, comme l’écrit fort
justement Joël Magny, " c’est cet effort qui
importe et non son aboutissement. " (1) Ce
pouvoir de libre interprétation qui est laissé
au spectateur, suivant qu’il soit croyant ou non, rend l’œuvre
d’autant plus singulière. Libre à nous d’y voir
une manifestation métaphysique de la religion ;
c’est-à-dire une réalité qui échappe,
voire contredit l’expérience (miracle, résurrection…),
cependant ces éléments mystiques stupéfient
par leur ancrage hyper-réaliste.
Maurice Pialat semble viser le réalisme, mais son ambition
est ailleurs : il s’agit de scruter ce qui, dans le corps,
les larmes, la douleur, échappe au langage. On parle
beaucoup dans son film, on use la parole, jusqu’à ce
point extrême où rien ne peut plus se dire et
où la passion doit déchirer les mots et les
corps. Loin de toute métaphore, de tout psychologisme
artificiel, il filme la réalité de façon
impudique, ce qui confère à son œuvre une violence
morale éprouvante. Pialat se fait le cinéaste
des sentiments crus et exacerbés. " Par les
mots ou par les images, le projet esthétique se confond
avec le défi spirituel. Comment susciter une nouvelle
vision des êtres et des choses ? "
(2) écrit Jean Collet à propos du film de
Maurice Pialat. La violence du sujet se traduit par une représentation
du chaos, où personne n’est bon, personne n’est méchant
: tout le monde souffre, se cherche et se déchire.
Toutefois Maurice Pialat ne cède pas au misérabilisme
et au pathétisme facile. Il louvoie habilement entre
maîtrise et perte de contrôle, entre lumière
et ombre pour exprimer les " oscillations du doute ",
expression empruntée à Joël Magny. Et Maurice
Pialat se place au premier rang des spectateurs, en interprétant
le rôle de Menou-Segrais, cet abbé à la
foi suspecte qui semble être la première intervention
du Malin dans la vie de Donissan.
|