| |
 |
|
|
Et ce rêve d’un
être-ensemble, justement récompensé (par
" les professionnels de la profession ")
d’un Grand Prix et d’un Prix de l’interprétation féminine
à Cannes à l’égérie Kati Outinen,
probablement suivi d’une bonne carrière commerciale,
est assez réjouissant. " Il arrive encore
souvent que les petites gens se lèvent de table rassasiés.
Ils y arrivent parfois, tout au plus, et difficilement "
(Ernst Bloch, op. cit.) Le succès permettra
peut-être enfin à Kaurismäki, après
vingt ans de résistance à bricoler un peu de
cinéma dans son coin, d’être pour une fois rassasié,
lui qui s’applique tant pour chaque film à mettre en
scène de chiches repas comme s’il s’agissait là
de plantureux festins. Il pourrait alors commencer à
ressembler à Claude Chabrol si, d’avoir connu la faim
et de continuer à boire, on ne s’en remet peut-être
jamais : " Mais celui qui touche un maigre
salaire n’échappe jamais au calcul et il fait rarement
des bonds " (Ernst Bloch, op. cit). D’être
à nouveau vivant et prêt au combat plutôt
que sursitaire d’une existence dont de toute façon
on a déjà été dépossédé,
c’est privilégier l’instant pointu et décisif
(le " kairos " comme dirait Giorgio Agamben)
à la viscosité de la durée. A y regarder
de plus près finalement, ce tabassage est paradoxalement
une manne pour le héros. Et la douce pluie qui mouille
ses vêtements permet aussi à son modeste potager
de se fortifier.
On notera en conséquence que la mise en scène
kaurismäkienne semble s’être désormais assouplie,
relâchée, désamidonnée (après
cette cure de rigueur que fut Juha). Plus cool,
elle ouvre grand ses plans aux espaces clairs et ouverts (ce
n’est pas encore du cinémascope, mais on y vient) ;
elle laisse traîner ces mêmes plans au gré
de quelques travellings au bord de l’eau (parfois tournés
à la steady-cam), les agrémentant de furtifs
fondus au noir et de recadrages discrets qui adoucissent les
jointures prévues par le découpage. Cette mise
en scène demeure malgré tout profondément
vissée sur trois ou quatre principes de fer et invariants :
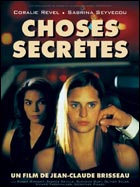 |
|
|
|
- un statisme des
postures et des scènes délibérément
anti-naturalistes (comme on le dit très clairement
dans le film, " l’école dramatique, c’est
en face !"), qui déplait au public français
lorsque le cinéaste l’est aussi (Choses secrètes
de Jean-Claude Brisseau) mais l’amuse, éloignement
géographique oblige, lorsque le cinéaste est
finlandais (c’est aussi la limite d’un art qui veut, comme
d’ailleurs les derniers films de Shohei Imamura, faire œuvre
populaire : le pittoresque),
- une colorisation pastel, à la Douglas Sirk, des espaces
du quotidien soumis à une théâtralité
de pure cinéma, volontairement artificielle,
- une poétisation souvent loufoque des dialogues (entre
le surréalisme et la langue fleurie de Queneau) dont
l’énonciation monocorde et vive (presque à la
Howard Hawks) camoufle intelligemment la surprise que constitue
un tel texte déclamé dans de telles situations
(Kaurismäki ne capitalise pas sur ses dons d’auteur).
A ce propos, Charles Tesson parlait très justement
dans sa critique de Au loin s’en vont les nuages d’une
forme originale d’" humour syncopée "
(Cinémathèque n°11, 1997, p.04 à
15).
| |
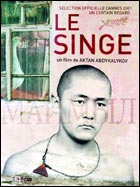 |
|
|
Kaurismäki ménage
ainsi et de mieux en mieux au sein de chaque séquence
de son film une triple approche simultanée (aucune
n’empiétant sur l’autre puisqu’elles sont indissociables,
toutes fondues dans le même regard, celui du metteur
en scène). A savoir un comique à froid du
genre de Buster Keaton (à équidistance du
cinéma de Kaurismäki, nous trouverons donc celui
de Takeshi Kitano et celui d’Elia Suleiman), un lyrisme
inspiré des mélodrames de Douglas Sirk mais
tenu sur un mode mineur et plus discret (bien que la bande
son soit comme souvent, sur le versant musical, abondante),
enfin une opération de réduction minimaliste
et d’abstraction découlant directement de l’œuvre
de Robert Bresson, on l’a dit, mais aussi de Yasujiro Ozu
(clin d’œil : M. mange japonais dans un des derniers
plans du film). Ce qui a pu influencer Akhtan Abdykalikov
pour son film Le Singe. Autre clin d’œil ? :
M. croise sur un chantier des ouvriers kirghizes, Kaurismäki
reconnaissant ainsi chez Abdykalikov ce que ce dernier a
précédemment reconnu chez lui.