Et tout cela donc pour produire quoi,
si ce n’est un épuisement sensible du sens commun que
chaque scène contient potentiellement. C’est le jeu
conscient que pratique le cinéaste avec le spectateur,
s’amusant des décalages (productifs d’un sens, d’une
vue inédite) sur les attendus clichés portant
sur la misère et sur les archétypes constituant
l’ossature de référence des films de genre dont
il emprunte sciemment, en les détournant pour les agencer
à sa façon, nombre d’éléments.
Le sens commun, épuisé par la mise en scène
kaurismäkienne qui par l’entremise de ses personnages
lance des propositions là où nous n’attendions
que de pâles confirmations, tombe à l’égal
des corps kaurismäkiens pour que se lève, à
l’instar de l’esthétique rossellinienne, une autre
image littéralement inattendue, forcément surprenante.
Dénuder la
misère sociale et lui proposer d’autres vêtements
pour qu’elle apparaisse comme jamais auparavant, digne sans
cesser d’être révoltante, mais aussi représenter
un amour " at first sight " auquel on
ne peut pas ne pas croire et auquel le cinéaste donne
tout son crédit (en redonnant à ce
terme son sens initial de " credo " :
c’est à la question de la croyance dans la
représentation que s’attache L’Homme sans passé)
parce que le cinéaste dit à nouveau, à
demi mot, à celle qu’il filme (Kati Outinen) qu’il
l’aime, c’est à la fois permettre :
| |
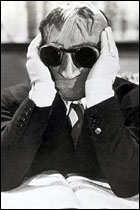 |
|
|
- que l’on puisse
voir cette pauvreté ou cet amour, tous deux filmés
avec les mêmes moyens et une égalité
de traitement qui force le respect, tels qu’ils sont (on
a déjà signalé le caractère
ontologique du cinéma kaurismäkien, on le répète :
n’existe chez lui que ce qui est, à un point présent
– le plan – d’un temps qui dure, temps de la douleur et
de l’épuisement), c’est-à-dire tels qu’on
ne les avait jamais vus ;
- et que la nouvelle image obtenue, image ayant fait peau
neuve, puisse mettre à jour les structures sociales
répressives qui ruinent la solidité des sentiments
et entretiennent la misère plutôt qu’ils ne
la combattent (Armée du Salut et ANPE comprises,
mais bien sûr aussi les banques et les entreprises
poussées à la faillite qui produisent une
précarisation de longue durée, crime qui profite
aux sociétés de gardiennage, police privée
n’avouant jamais son nom). Kaurismäki n’est donc absolument
pas un idéaliste éthéré mais
un réaliste forcené qui donne du style (la
connaissance intellectuelle) au regard (la connaissance
perceptuelle) qu’il a et qu’il nous donne sur le réel.
" Pour peu
qu’on ne se laisse pas arrêter par l’aspect extérieur,
mais qu’on pénètre dans les ruelles ou la
cour d’un bidonville, on aperçoit immédiatement
les signes d’une activité humaine organisée
(…) Contrairement à une opinion aussi fausse que
répandue, le bidonville n’est pas un tas de baraques
informes et indignes de l’homme " (Colette Pétonnet,
On est tous dans le brouillard, Editions du Comité
des Travaux Historiques et Scientifiques, Coll. Références
de l’ethnographie, 2002, p. 61). C’est, croit-on, un peuple
émietté, déclassé, déporté
en bordure du pôle industriel du pays (constat de
L’Homme sans passé : la classe ouvrière
de Shadows in Paradise n’est plus), sans récit
ni chanson (autre constat : La Vie de Bohème
ne semble même plus permise), sans théâtre
ni bal, sans style ni image autre que l’odieux discours
d’une charité qui s’enquiert davantage de ce qu’elle
veut, fait et contrôle plutôt que de ceux qui
en font les frais (leur misère est la même,
c’est juste que la mort est un peu plus longue à
venir). Et ce peuple se voit restauré (dans) ses
droits, via l’action du personnage au cœur du bidonville
dans l’espace diégétique du film, et via la
mise en scène du cinéaste dans l’espace esthétique
qu’il a circonscrit pour son film. Celui de vivre et d’être
heureux : la joie est le carburant nécessaire
pour des lendemains qui, pour sûr, chanteront.
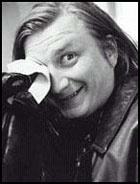 |
|
|
|
Cette image restaurée
après avoir été laminée par
la coercition administrative (voir la scène hilarante,
vaguement kafkaïenne, de l’avocat au commissariat)
est à l’instar du juke-box récupéré
dans une décharge par le placide M. Remarquons qu’il
est un M. de moins en moins maudit puisque L’Homme sans
passé fait doublement référence
au film de Fritz Lang et à l’univers marxiste et
stylisé de Bertolt Brecht dont la verve sociale et
distanciée avait justement influencé ce dernier
pour M le maudit. Cette image est pour, est celle
d’un peuple recomposé (le protagoniste fait d’ailleurs
moins penser à L’Homme invisible de James
Whale qu’à la créature de Frankenstein,
filmée également par Whale). Et elle n’a rien
à voir avec une quelconque transcendance impliquant
soumission et servilité à un pouvoir et une
vérité située au-delà et sur
lesquels nous n’avons aucune prise (significativement, l’Armée
du Salut se met à chanter pour le plaisir de tous
des tubes rocks tombés en désuétude)
mais est elle-même, comme le distinguait parfaitement
Ernst Bloch, transcendante (et donc non transcendantale).
C’est-à-dire signifiant cette révolte qui
dynamise l’homme afin de lui éclairer les raisons
de ce qui le mine en lui ouvrant les portes du possible
et du futur.