| |
 |
|
|
Le fauteuil aérodynamique
et mou reprend sa forme initiale après que l’on se
soit assis dessus. Ce qui fait marque ici, c’est le charbon
sur le goulot de la bouteille de vin qui signe la fraude d’un
ouvrier de l’établissement (et le maître d’hôtel,
puisque c’est lui le fautif, est rappelé à sa
condition d’exploité comme ceux dont il est le supérieur
hiérarchique), à la bouche toute cerclée
de noir (variation d’un gag de " Jour de fête)
; ce sont les dossiers des chaises du Royal Garden, son logo
(une couronne à cinq branches) dont le motif s’est
déposé à même la peau des clients.
Fer de marquage pour les bêtes destinées à
la vente ou l’abattoir, inscription d’incarcération
digne de A la Colonie pénitentiaire de Kafka,
résurgence douce de l’univers concentrationnaire auquel
Tati, plus jeune, a réussi à échapper.
Soit on est marqué visiblement sous le sceau de son
asservissement marchand, soit on est voué à
l’invisibilité, signe d’un assujettissement plus pervers
encore : au signe distinctif de consommation (la marque,
la griffe) succède la marque première (et barbare
comme dirait Walter Benjamin) de l’exploitation prolétaire,
celle de ne pas être vu au travail de sa propre exploitation.
Hulot partage cette condition à l’invisibilité
avec les ouvriers du film, population tenace (et déjà
dans Mon Oncle, elle n’en démordait pas) qui
renvoie directement à celle, réelle, de Play
time en tant qu’entreprise, usine de production cinématographique,
et que Tati n’a au contraire jamais ignorée. On n’a
peut-être jamais aussi bien filmé avec attention
et avec respect la classe ouvrière dans le cinéma
français. Et la manière sans atermoiement avec
laquelle on essaie de la faire disparaître à
grand coup de plumeaux, à coup sec de torchon. Montrer
chez Tati équivaut à désigner (à
dessiner, à designer) l’intolérable accepté
de nous, tel qu’il n’a jamais cessé d’être, sous
l’auspice du rire (et de la fonction pédagogique que
lui assigne l’auteur de Parade). Le rire comme lunettes
d’appoint, le rire comme garde-fou.
Espace publique-espace privé :
le raccord et l’échange du dehors et du dedans.
" Le spectacle n’est
pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des
personnes, médiatisé par des images (…) C’est
une vision du monde qui s’est objectivée (…) Mais la
critique qui atteint la vérité du spectacle
le découvre comme la négation visible de la
vie ; comme la négation de la vie qui est devenue
visible " (Guy
Debord, opus cité, pp. 04 et 06).
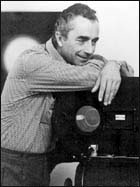 |
|
|
|
La socialité-sociabilité
du film est polarisée en différents lieux de
rétention qui sont toujours des lieux de servilité
(employeur-employé, mari et femme dans une terrible
symétrie de la domination esquissée dans Mon
Oncle). De domesticité. Le social est instrumentalisé
par la loi du marché qui se doit d’effacer en conséquence
les propres traces (le signe de sa barbarie selon Walter Benjamin)
des rapports (aliénants) de production qu’elle induit
mécaniquement. Et cette mécanique n’est rien
d’autre que de l’idéologie capitaliste qui, en plus
de légiférer l’espace publique, a envahi dorénavant
l’espace privé, en affectant définitivement
le jeu de relations qui s’y jouent.
La rencontre fortuite de Hulot avec un ancien collègue
de l’armée qui décide de l’emmener visiter son " home "
est de ce point de vue très instructive. Si tout communique
comme chez la famille Arpel de Mon Oncle, plus rien
ne se dit : les cadeaux évitent de parler avec
son conjoint ou son enfant, les gadgets dont il faut déployer
l’ingéniosité ou la richesse d’invention masquent
un déficit communicationnel uniquement basé
sur l’épate matérielle, la TV déplace
ou neutralise l’intérêt que l’on pourrait avoir
pour l’autre au nom d’une incommunicabilité prévenant
une fatigue existentiel cumulée à celle de la
journée passée au travail. Allant même
plus loin que ce constat pas si éloigné de ceux
dressés par Michelangelo Antonioni son contemporain
(qui lui rendait hommage dans un gag de L’Eclisse en
1963), Tati montre aussi que la baie vitrée du salon
de cet appartement standard situé au rez-de-chaussée
et donnant sur la rue renvoie à la nullité spectaculaire
d’une telle vie privée qui ne souffrira jamais de l’amincissement
de son intimité au profit de la participation sans
douleur du regard publique à sa pantalonnade. Consommer,
c’est aussi être des yeux consumé.
|