|
" Le verre
(…) est un matériau dur et lisse sur lequel rien n’a
de prise. Un matériau froid et sobre, également.
Les objets de verre n’ont pas d’aura. Le verre, d’une façon
générale, est l’ennemi du mystère "
écrivait Walter Benjamin en 1933 au sujet de L’Architecture
de verre de Paul Scheerbart (In Œuvres II, Gallimard
Folio essais, 2000, p. 369) . Si la vitre permet, en soulignant
la spectacularisation en cours de l’espace intime que
poursuivent aujourd’hui les téléphones portables
et les webcams, de renouer avec le cinéma muet (Manoel
De Oliveira dans Je rentre à la maison
en 2001 procèdera pour certaines séquences de
la même manière), elle distingue aussi cette
logique de réversibilité qui voit l’extinction
du lieu en tant qu’espace de durée (la demeure) pour
devenir celui d’un passage de moins en moins long à
pratiquer et qui ressemble de plus en plus à une salle
d’attente.
| |
 |
|
|
La Ville comme antichambre
ou purgatoire d’une humanité en voie de devenir ectoplasmique
fait songer à une vaste fourmilière. Et justement
sur ce point Alain Resnais apprit un jour que " dans
la fourmilière 30 % des fourmis font mine de s’activer
mais ne foutent rien d’autre que s’agiter pour donner l’impression
d’abattre un travail épuisant " (in Positif,
n°442, décembre 1997). On pense inévitablement
au majordome du Royal Garden dont la stricte fonction est
de surveillance et de représentation, le simulacre
rôdé et virtuose de l’intense dévouement
et de l’inlassable activité au service du client-roi.
Aujourd’hui la Ville est le lieu même de ce trafic,
de cette Comédie du Travail (qui est aussi le
titre et le sujet du film d’un cinéaste tatien, Luc
Moullet).
Reproduction-consommation :
la (grande) surface
et la répétitivité.
" Cet immense
système de sollicitude vit sur une contradiction totale.
Non seulement il ne saurait masquer la loi d’airain de la
société marchande, la vérité objective
des rapports sociaux, qui est la concurrence, la distance
sociale croissante avec la promiscuité et la concentration
urbaine et industrielle, mais surtout la généralisation
de l’abstraction de la valeur d’échange au sein même
de la quotidienneté et des relations les plus personnelles
(…) Destiné à produire de la sollicitude, il
est voué à produire et à reproduire
simultanément de la distance, de la non-communication,
de l’opacité et de l’atrocité "
(" Playtime, ou la parodie des services "
in Jean Baudrillard, La Société de la Consommation,
Paris, Gallimard, 1970, p.258).
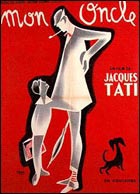 |
|
|
|
L’humanité
de Play Time est fonctionnelle, dépersonnalisée,
standardisée. Elle se meut selon des trajectoires programmées
dans l’imbrication supposée performante d’espaces de
fonctionnalité que visite de façon impavide
cet éternel étranger, ce touriste, ce vacancier
qu’est Hulot, notre guide angélique, notre semblable,
notre frère céleste (l’aéroport qui ferme
Mon Oncle et qui ouvre Play Time), notre boussole
dans l’enfer glacée de notre modernité. Il est
une " velléité de personnage "
(Michel Chion) qui paraît toujours en porte-à-faux
là où il se trouve, éternel déplacé
dont la passivité signe en dernière instance
sa résistance opiniâtre à toute incorporation
violente (l’armée qui sert pour deux anciennes connaissances
à se rappeler à lui, l’armée comme processus
d’intégration et de socialisation, comme le seul souvenir
d’une histoire commune, l’armée comme vérité
définitive d’un monde ordonné jusqu’à
l’asphyxie, l’armée c’est déjà loin,
c’est toujours là).
Révélateur malgré lui de l’entreprise
d’homogénéisation totale qui se joue là,
sur lui, contre lui (un burlesque est toujours un paranoïaque :
c’est le monde ou lui !), Hulot est, erre, flotte, poussière
archaïque d’une humanité passée que les
aspirateurs (avec phares !) du modernisme, de la fureur
du tout technologique, ont pour tâche d’engloutir. Si
l’enrégimentement suinte de partout, Hulot passe quand
même au travers des gouttes.
Même son unicité est noyée dans le flot
continu de la valse de ses doubles surprises (Hulot cloné !).
La seule chose d’unique ici c’est le film, grande surface
profonde artistiquement, impossible à reproduire esthétiquement
et qui aligne cube scénographique sur cube scénographique
en démontrant la stratégie publicitaire (cette
culture massifiante et itérative) qui les gouvernent.
Une colonne grecque présentée dans un stand
? En fait c’est une poubelle pratique et amusante ! Même
les rats ne sont ici que des simulacres de fourrure bons pour
les femmes du monde (il n’y a pas d’autre animal que l’espèce
humaine dans Play Time). C’est l’utile qui, rejoignant
l’agréable, trace la ligne d’horizon désespérément
plate d’une société vouée à être
assignée aux lois de la consommation, aux valeurs suprêmes
d’usage et d’échange.
|