| |
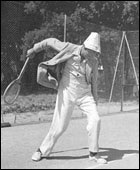 |
|
|
C’est pourquoi le
célèbre parapluie de Hulot, véritable
extension organique, lui sert à beaucoup de choses :
c’est une canne qui lui permet de ne pas tomber (mais
aussi une épée de chevalier courage, des ailes
d’ange qui l’empêchent de voler, etc.). A tout donc
sauf à se prémunir d’une pluie imminente qui
ne viendra pas, malgré le ciel qui ouvre Play Time,
lourds de nuages gris. Subversion de Tati : cet objet
ne se définit plus par rapport à la fonction
première qui le constitue en tant que parapluie, son
existence technique est emmenée par Hulot au-delà
de sa stricte définition fonctionnelle. De toute façon
ici, il ne pleut pas. Pire, il ne pleut plus. Il faudra attendre
la fin de Trafic pour qu’un crachin promis par le parapluie
de Hulot ait enfin lieu, modeste épiphanie dans un
monde qui en est singulièrement dépourvu (dans
ce film il n’y a presque plus d’enfants), préférant
les joies calculées d’un feu d’artifice consumériste
et technologique que Hulot dans Les Vacances de M. Hulot
lançait (maladroitement pour lui, significativement
pour nous) trop tôt, ruinant par avance l’effet factice
d’événement promis par le pétaradant
gadget.
Le dur et le mou :
la volatilité
du gag et la distribution centripète du son.
" L’activité
de l’ethnologue de terrain est dès le départ
une activité d’arpenteur du social, de manieur d’échelles,
de comparatiste au petit pied : il bricole un univers
significatif, au besoin en explorant (…) des univers intermédiaires "
Marc Augé, opus cité, p. 21-22
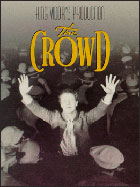 |
|
|
|
La seule arme dont
dispose Tati en tant que metteur en scène cette fois-ci,
c’est la modernité esthétique qui, non pas disqualifie
les injonctions et les codes institutionnalisés par
ce haut-lieu, ce parangon dur et massif de la nouvelle socialité-sociabilité
(autrement dit plus efficace, plus productive, directement
connectée à la grande machine de production
marchande) qu’est la Ville (Paris, cité anonyme et
internationale, semblable à n’importe quelle autre
métropole) mais chercherait plutôt par son formalisme
pointilleux à lui faire rendre gorge, à l’exténuer
en la sur-signifiant de détails plus insolites les
uns que les autres.
La mollesse ontologique de Hulot (son chapeau gondolé,
son parapluie flottant, son imper froissé, son visage
souple, ses velléités professionnelles) contredit
par l’élasticité de son être la matérialité
indestructible de structures de socialisation comme des discours
rigides qu’elles contiennent. Que peut le dur lorsque le mou,
signe même de l’enfance, est si peu unifiant ?
Si Play Time est l’anti-Metropolis par son refus
de tout alarmisme ou catastrophisme idéologiquement
suspect, il serait plutôt une sorte de suite à
The Crowd (1928) de King Vidor (mais un The Crowd
sans la tragédie américaine de l’individualisme
et du sujet) ou alors de Modern Times II dégraissé
d’une dramaturgie de la violence technologique trop voyante
(et la parenté des titres n’est, semble-t-il, pas une
coïncidence) comme s’il avait été réalisé
par un Buster Keaton dans la continuation de son œuvre (on
pense à son court métrage Electrical House
en 1921) (2). Comme chez ce dernier, on ne se moque
des objets qu’à condition de les inventer soi-même en
leur impulsant des intervalles élastiques de jeu à
l’intérieur de leur codification d’usage : la critique
se fait à ce prix, en mettant directement la main à
la pâte. Il s’agit quand même de se faire au moins
aussi intelligent que l’intelligence artificielle dont on
cherche à décortiquer les mécanismes
dominants, à détailler les circuits fondamentaux,
à déconstruire l’idéologie qui l’habite
(et la meilleure arme de celle-ci est de se cacher dans ses
plis les plus fins, les plus ramassés).
|