| |
 |
|
|
L’enseigne lumineuse
du Royal Garden est comme le symbole-clé du film, au-delà
de la désignation par Tati de sa fonction programmée
d’alpaguer du chaland friqué (ce qui est drôle
ici est que cela marche trop bien, davantage que ce qui était
vraisemblablement souhaité), quant au rapport que le
cinéaste entretient avec la question du son dans son
cinéma : il s’agit à bien y regarder de
l’image du pavillon d’une oreille. Les multiples niveaux ou
pistes sonores que Tati met en place (musique extra ou intra-diégétique,
phonèmes et parlures se substituant aux classiques
dialogues, bruits courts ou longs souvent difficilement localisables,
etc.) affectent en profondeur l’écran, le dotant d’une
troisième dimension qui donne au film son aspect cubiste
ou environnemental, permettant d’abord à son concepteur
une approche d’observation critique de type structuraliste,
lui donnant ensuite la capacité d’accueillir dans l’immensité
d’espaces ainsi déployés une forme de fourmillement
qui participe au contrat ludique établi avec le spectateur.
Très souvent, le son dans la distribution significative
de ses signaux affecte la visibilité du plan :
on croit voir au début de Play Time une clinique,
il s’agit en fait d’un aéroport. Ainsi, le gag obtenu
(dans un esprit assez proche de Jean Cocteau) dans une compréhension
après coup perd de sa puissance d’instantanéité
comique certes, mais au profit de l’instauration d’une image
mentale coexistant avec l’image réelle, une image virtuelle
(la clinique) qui court-circuite l’image actuelle (l’aéroport)
parce qu’elle en révèle une vérité
enfouie. Cette odeur d’hôpital qui ne règne pas
seulement qu’à l’hôpital est aussi celle qui
accompagnera le cinéma de David Cronenberg ou un film
comme Safe de Todd Haynes en 1996. La Ville comme réserve,
zoo de prestige : l’espèce humaine se sait menacée.
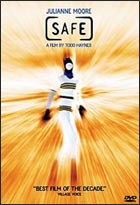 |
|
|
|
C’est à peine
le souvenir de la guinguette qui s’actualise temporairement
lors de la surchauffe du Royal Garden, sourire à peine
esquissé d’un temps que, comme le dit la chanson, les
moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. D’un temps
survivant dans le cellophane de ses clichés. D’un autre
monde possible dont l’utopie (la fête ivre d’après
la fin de la lutte des classes) est furtivement touchée
du doigt avant de s’enrouler dans un petit tourbillon gazeux
et de disparaître, tels ces nuages ouvrant le générique.
Cette tension dialectique entre la bande-image et la bande-son
(seuls en France dans les années 60 Robert Bresson,
Alain Resnais et Jean-Luc Godard sont avec Tati ceux qui ont
le plus travaillé cet aspect régulièrement
laissé de côté dans le cinéma)
redéfinit fortement la constitution même du gag
devenu plus mystérieux, moins facilement situable,
gazeux ou volatile. Echappant à la vigilance du
spectateur, il demande un surcroît d’attention mais
dans le même mouvement, son importance se relativise :
loupé, le plan n’en mourra pas malgré tout.
Le gag ne se donne plus tant à voir qu’il réclame
surtout que le spectateur aille le dénicher. On touche
là au nerf sensible du chef-d’œuvre de Tati :
si le film est drôle, c’est que le regard qui l’anime
produit de la fantaisie là où celle-ci est définitivement
exclue des parages.
Ce qui fait rire, c’est l’introduction en biais (en cela le
son y aide beaucoup) d’un axe de vision qui ouvre la frontalité
des plans et leur terne contenu au comique, mais un comique
tout à fait original, dont les tenants sont du cinéaste
(l’installation du gag) mais dont les aboutissants (lorsque
le gag est actualisé) résident dans les images
qui peuplent l’imaginaire du spectateur. Sans le regard de
Tati comme première béquille et le nôtre
comme seconde béquille, ce monde qui est notre monde
s’effondrerait de son poids mort (un embouteillage qui ressemble
à un manège, un lampadaire à du muguet,
c’est moins navrant), celui de son sérieux.
|