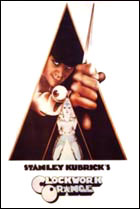 |
|
|
|
Jouant du zapping, de la fonction « rewind »
du magnétoscope (comme l’avait déjà fait Michael Haneke avec
Funny Games en 1997) et des effets de désensibilisation
produits par l’abus de cocaïne mais appliqués à la narration
du film, le cinéaste réussit à être l’agenceur/séquenceur
d’un dispositif plastique en quatre dimensions, chacune de
ces dimensions étant un des quatre protagonistes du récit
(Sean, Paul, Lauren et Victor), qui multiplie les possibilités
de connexion ou d’embranchement sans qu’aucun de ceux souhaités
par les personnages n’ait pourtant lieu. The Rules of attraction,
s’il s’apparente à une sarabande grotesque lorgnant du côté
des pantins pop et des masques grimaçants de A Clockwork
Orange (1971) de Stanley Kubrick (cf. les reprises techno
ou rap des classiques de Bach, Beethoven et Verdi témoignent
de cette influence), se trouve être en fait une élégie mélancolique
nimbée d’une réelle sensibilité, en cela très proche de Bande
à part (1964) de Jean-Luc Godard (la visite au Louvre
en quatrième vitesse se voit substituer chez Avary par une
série d’haltes dans les capitales européennes filmée en caméra
numérique hyper speedée et en débit recto tono d’une
blancheur monocorde qui fait penser à une compression de César).
Ce n’est plus le monde qui fait selon les termes d’un mauvais
scénario bande à part mais mon plus proche (voisin de chambre,
camarade de classe, copain ou copine) dont la vie est un film
déjà vu cent fois, qui n’est pas raccord avec le mien et ne
le sera jamais. L’utilisation de l’arrêt sur image avec agrandissement
photographique et du split-screen participent logiquement
d’un éloignement de tout accord d’objectivité, de tout consensus,
au profit d’une subjectivité hypertrophiée, en roue libre
et en circuit clos, accusant l’éloignement de sa propre expérience
vécue dans une image qui n’est déjà plus redevable d’un moi
particulier mais d’un réservoir commun d’icônes et de fétiches.
« Typical » comme disent les protagonistes du film
pour lesquels tout semble déjà avoir eu lieu, tout paraît
être gagné par avance. La mascarade sarcastique et bouffonne
qu’incarne une bande de dealers plus déjantés que ceux du
compère Tarantino coule (la surchauffe visuelle, la neige
remplaçant la cocaïne) et laisse ainsi s’épancher un fort
sentiment nauséeux de tragique existentiel.
| |
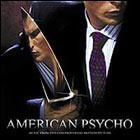 |
|
|
Réussissant la vraie première sitcom d’auteur
ou adulte que Matthieu Kassovitz feignait mollement de représenter
dans Assassin(s) en 1997 ainsi que la première adaptation
d’un livre de Bret Easton Ellis (à oublier l’épaisse transposition
cinématographique de American Psycho d’il y a deux
ans), Avary sait forcer l’intériorité d’images subordonnées
à la mécanique de leurs codes (sur laquelle d’ailleurs le
cinéaste renchérit avec une outrance et une virulence assez
rares) en multipliant les voix-off qui valent autant comme
preuve d’une déréalisation et d’un détachement décrits plus
haut que la preuve aussi que des vies et des espoirs se jouent
ou meurent là, chacun de leur côté, tout juste les uns à côté
des autres (6). C’est le suicide d’une jeune fille,
le seul pied de sa courte vie, suicide filmé comme un shoot
ou un happening, et dont personne ne saura rien (on pense
ici particulièrement aux travaux de la vidéaste suisse-allemande
Pipilotti Rist qui ont aussi influencé David Lynch). C’est
un soirée étudiante « fin du monde » qui n’est que
le lieu, excluant toute acmé ou résolution dramatique que
le spectateur désirera en vain, de trajectoires simultanées
qui ne sont décidément jamais arrivées à se croiser, comme
autant d’asymptotes relancées exponentiellement vers l’infini.
Le drame se situe résolument ailleurs.
Le nietzschéisme de Larry Clark réalisant Kids en 1996
et surtout Bully en 2001 lui permettait de ne jamais
figer son registre filmique dans les pièges didactiques du
film-dossier, privilégiant toujours les corps aux discours
que ces mêmes corps s’amusent à susciter. Le romantisme réel
et noir de Roger Avary pousse ce dernier à multiplier les
ruptures (de ton, de narration) et à zigzaguer entre elles
afin de sauver ce qu’il peut y avoir d’encore vivant dans
des figures trépassées (on n’est alors pas très éloigné de
Bringing out the dead (1999) de Scorsese et on ne peut
donc qualifier sa posture de nihiliste) mais ce, sans jamais
feindre d’ignorer que ces figures, dont la pulsion de mort
est entretenue par le libéralisme universitaire, sont sursitaires.
Le pire est peut-être encore à venir. Information de taille :
les filles se suicident mieux que les garçons aux USA. Ce
qu’il reste à faire à ces derniers, survivants-assassins en
puissance (une alternative parmi d’autres) : trader à
New York (cf. American Psycho) ou soldat dans le mauvais
film au scénario couru d’avance qui se joue en ce moment sous
la supervision de l’administration Bush en Irak et que retransmettent
consciencieusement toutes les télés vassales du monde. Dans
les deux cas, il faut compter avec de vrais morts, en sursis
ou non. Images comprises, qui viennent mourir dans ce Ground
Zero qu’est définitivement le teen movie ou la
télévision.
|