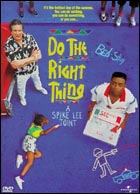 |
|
|
|
Les boursouflures et les fioritures ne sont
pas toujours évitées mais encore une fois elles vont dans
le sens d’une puissante dialectisation des discours ambiants.
Lee lui-même, accompagnant au plus près son personnage comme
hier John Huston regardait Montgomery Clift dans The Misfits
en 1960 (9), semble en conséquence vouloir se retirer
d’une ancienne posture « communautarisante » que
Malcolm X en 1994 avait exemplairement, et ce jusqu’à
l’ambiguïté, représentée. Posture qui dans sa version intégriste
a pu donner tant les fondamentaliste protestants américains
que Ben Laden. On n’a pas semble-t-il insisté sur l’ambiguïté
dont se nourrit la nouvelle phase de l’œuvre de Lee, ce qui
le rapprocherait de Orson Welles mais aussi de Jean-Luc Godard.
La trahison par la petite amie, au-delà de tout jugement moral,
n’était-elle déjà pas l’aboutissement de A bout de souffle en
1959 ? Les faux-raccords lyriques font formellement bégayer
les embrassades typiquement américaines de femmes et d’hommes
élevés dans l’idéologie la plus mensongère qui soit, celle
d’un « tous ensemble » qui trouve dans « la
croisade du bien contre l’axe du mal » professée par
Bush sa véritable résolution. Ce que filme le cinéaste, avec
l’attentat du 11 septembre dans le rétroviseur, c’est le sol
qui se dérobe sous les pieds de personnages ni meilleurs ni
pires que d’autres, c’est un socle de certitudes qui vole
en éclats et qui prouve à quel point l’attentat peut servir
de salutaire catalyse, de nécessaire catharsis. Do the
right thing, certes mais qu’est-ce qu’une « bonne
chose » au vu d’un tel contexte ?
Ce sont les possibles qu’alors on développe quand le réel
est à ce point miné, grêlé, tapissé de fausses valeurs hier
encore acclamées et aujourd’hui considérées à raison comme
des pièges aliénants : un rêve d’établissement familial
loin de tout, à tous égards correspondant à cette seconde
chance qui est l’un des paradigmes de la thématique américaine,
trop cliché, trop usé (cf. les couleurs délavées de la séquence
en disent long) pour pouvoir être vrai. Ce sont les couches
de passé que l’on extrait par exemple des plis d’un canapé,
bonheur conjugal trop beau pour avoir été si vrai, et qui
n’empêchent pas l’avenir de pourrir le présent de tant d’hypothèses
et d’incertitudes que rien ne semble devoir lever. Ainsi la
prison pour Monty qui permet au cinéaste de réussir le tour
de force de réaliser l’un des plus beaux films de prison récents
sans rien filmer de celle-ci, dont l’horreur est uniquement
convoquée à travers un fond commun dispensé par les médias
et partagé par tous et aussi par l’expérience de quelques-uns
(10). Autre réussite également, celle de figurer également
le puritanisme excessif et hypocrite qui sclérose l’ami Jacob
et inhibe sa sexualité, censure participant à la confection
de l’édifice moral décrit précédemment. La « guerre préventive »
de Bush ne commence pas autrement que dans la mise au pas,
le rappel à l’ordre et la bride accolée à toute une population.
| |
 |
|
|
Dernière réussite, et non des moindres,
d’un film gorgé comme un œuf de dires au risque de trop en
faire : celle de représenter un dealer qui a vécu son
activité comme parfaitement raccord avec l’apologie de la
réussite individuelle promue par le néo-libéralisme actuel,
à l’instar du couple du dernier film de Abel Ferrara, R’Xmas
(2001), et qui se voit reprocher par son ami, golden boy
travaillant à Wall Street à la captation frauduleuse de la
valeur produite par les travailleurs américains (d’Enron ou
de Worldcom par exemple) et spéculant sur le maintien des
chiffres du chômage, sa petite fortune bâtie sur le malheur
et la dépendance d’autrui ! Autre vingt-cinquième heure :
celle des pros du boursicotage. Autre Ground Zero :
Wall Street. L’attentat du 11 septembre aura été cette éraflure
dont les stigmates (drapeaux, photos) et les récurrences symboliques
parcourent tout le film de Spike Lee, du chien blessé recueilli
par Monty à son visage tuméfié à la fin, crevant l’abcès d’un
pays gâté de trop d’autosuffisance, croyant en son inébranlable
puissance. La baudruche dégonflée, les images de Spike Lee
recueillent la poussière de ces états (d’Amérique) de vide
pendant que les corps titubants du film gonflent de tristesse,
de désir, de rage, d’orgueil. Et qu’un hors-champ menaçant
(la prison pour Monty, la guerre en Irak pour nous) ne cesse
d’enfler alors qu’un autre (Wall Street) n’est toujours pas
prêt de descendre de sa tour d’ivoire et d’apparaître pour
ce qu’il est, un autre ballon de baudruche que la raison aurait
dû déjà crevé.
|