| |
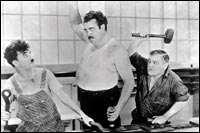 |
|
|
En outre, le cinéma qu’il avait contribué
à bâtir n’existait plus, une nouvelle industrialisation s’était
imposée, plus efficace et avec de nouvelles technologies.
Agé de quarante trois ans, extrêmement riche, il est à un
tournant dans son cinéma. Alors qu’il jouit du capitalisme
(dont il est fier (3)) son personnage de Vagabond incarne
l’extrême dénuement qui ne capitalise rien. Rouge des salons
mondains du monde entier, Chaplin est connu pour sa capacité
quasi hargneuse (4) à prendre sa revanche tout en s’accaparant
l’amour du monde entier. Or comment faire encore exister son
personnage de vagabond muet dans un monde qui change de plus
en plus vite ? A-t-il encore la capacité (morale, politique,
esthétique) d’être muet dans un monde qui parle ?
QUELLE PAROLE ?
A revoir ces Temps Modernes
en 2003, ce qui frappe n’est pas tant la critique sociétale
réjouissante du monde du travail et toujours aussi actuelle
sous ses apparents dehors datés, que l’usage radiophonique
du cinéma. Le son au cinéma pour Chaplin ajoute autre chose
qu’un plus de réel. Il faut rappeler qu’il a fallu dix ans
et trois de ses plus grands films pour que le cinéaste passe
du muet au cinéma parlant (City light en 1931, Modern
Times 1936 et The Great Dictator 1940) La musique
demeure la partenaire privilégiée du mime mais aussi et surtout
elle joue l’effet montage de la narration où l’oreille, plus
rapide que l’œil, donne à voir. Faites cet essai : coupez
le son d’un film Chaplin et essayez de le regarder. Quelque
chose manque. Non pas tant l’expression (on ne dirait jamais
assez l’acuité du regard cinéaste sachant créer de véritables
portraits humains) ou le sens (rien n’est jamais caché, tout
est à déchiffrer) mais le mouvement émotionnel. Le film est
musical du début à la fin.
 |
|
|
|
De plus, Les Temps Modernes joue
sur l’hybridation sonore et auditive pour rendre compte
d’un parti pris formel audacieux et réactionnaire en même
temps. Le carton scriptible côtoie le son enregistré des
machines (usage naturaliste et surréaliste en même temps)
aux paroles émises par des bouches qui parlent immédiatement
retransmises par les ondes. Le circuit de la parole est
à la fois diffracté et dans le même mouvement clivé. Lorsque
le patron parle, ce n’est pas un parmi tant d’autre mais
la figure et la voix du Patronat où le détour par les machines
de retransmission audiovisuelles et sonores rend possible
cette abstraction. Il n’est plus une personne, un individu
mais un concept économique et politique : le capitalisme
et le taylorisme. Diffusé du haut du bureau (l’émetteur)
à l’ensemble de l’usine sans réponse possible du récepteur.
Le premier clivage politique de la communication se situe
à cette quasi-impossibilité physique pour l’ouvrier de répondre
au « patron » face à face et dans l’instant.
Lorsqu'il fume aux toilettes durant sa courte pause, Charlot
est interrompu dans ce moment de trêve intime par
l'irruption gigantesque du visage de son patron. Après
avoir pointé, il ne cesse de regarder par devant-lui
afin de s'assurer que personne ne le surprend à fumer.
Premier indice du contrôle des corps qu'opère
l'entreprise. Sans remarquer qu'un écran blanc le
regarde derrière lui. Assis au bord du lavabo,
il est sur le point de se détendre enfin quand une
voix surgit. Nous voyons l'écran s'allumer et apparaître
un visage d'un homme à noeud de papillon assis à
son bureau. L'ouvrier sursaute violemment à l'injonction
eh vous. Il se retourne et découvre son patron
démesurément présent. Il tente de se
justifier par geste (l'ouvrier est l'homme sans parole).
Sans succès : Retournez immédiatement
au travail. Plus vite ! La parole d'un visage démesuré,
quasi monstrueux dans cet espace clos, ordonne à
un corps silencieux qui ne peut pas répondre à
une image. Cette surveillance panoptique sonore et visuelle
(omniprésence de la toile blanche muette dans l'usine
jusque dans les chiottes où le contrôle des
matières fécales ressort aussi du patronat...)
illustre chez certains cinéastes contemporains de
Chaplin l'ère de la modernité carcéralisée
(avec la voix pour Mabuse chez Fritz Lang.) Surveiller et
punir dirait Michel Foucault.
La cadence tout comme la parole est un enjeu de pouvoir
et d’aliénation. Son corps appartient à l’usine comme à
la prison où la régression, ici est au service du rendement,
là au nom de la sécurité de la société. Dans la rue, il
se retrouve désemparé (qui/quoi l’empare ?) : comment faire
pour survivre ?