
Comme chez les Expressionnistes, Lang en
tête avec ses mouvements de foule, révolutionnaire, réactive,
c’est au travers d’une vision large du groupe, de ses errances
- Dodeskaden -, de ses mouvements de colère ou de ses
aspirations - Entre le Ciel et l’Enfer, L’Ange Ivre
- que la foule se disloque et laisse paraître l’individualité
qui s’en trouve comme renouvelée. Les hommes alignés et prêts
à se séparer dans une parade expressionniste, comme auparavant
Eisenstein alignait les combattants de la Grande Russie contre
les soldats de Kazan, tiennent de cette contradiction : l’ordre
existe, il a progressivement gagné toutes les strates de la
population renforcée ou, au contraire, contrariée par ce système,
tout en donnant l’apparence de cohésion à la société dans
son ensemble. Le soldat est gracieux, efficace, sa maîtrise
des arts ancestraux en fait plus qu’un champion efficient,
une mécanique imparable. Il peut, en cela et à l’instar de
Shimura Takashi dans Les Sept Samouraïs, relever n’importe
quel défi. La fin du film est quant à elle plus équivoque,
après avoir secouru le village assiégé par les bandits, les
trois samouraïs survivants contemplent le terre-plein ou leurs
compagnons sont enterrés, quelques mètres au-dessus des modestes
paysans. L’homme traverse l’existence au sein d’une communauté
qui, souvent, l’exclut -on ne compte plus les personnages
solitaires ou marginaux attribués à Toshiro Mifune particulièrement,
le malade paria de L’Ange Ivre ou le Ronin de Yojimbo
-, le terme du labeur se trouve seul dans la mort. Si
la société ne sait apporter de signifiant, Kurosawa promeut
une recherche personnelle, poétique toujours, la quête de
l’esprit libre pour donner sens et justifier l’existence passée.
C’est dans la lutte qu’apparaît la possibilité de raisonnement.
| |
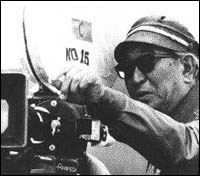 |
|
|
On pense à Roland Barthes, pour qui cette
société du Zen « mène la guerre contre la prévarication
du sens » et « déjoue la voie fatale de toute assertion »
(Roland Barthes, L’Empire des Signes), et où l’homme
a finalement tant de mal à justifier sa propre identité, et
son individualité. Aussi ces personnages solitaires qui vont
seuls jusqu’à leur destinée - c’est le cas du vieillard de
Vivre, du vieux professeur de Madadayo - sont
souvent fantaisistes, considérés comme idiots. C’est ce moment
décisif que filme Kurosawa, le moment où l’existence monotone
et routinière gagne en sens. Les plus jeunes - Toshiro Mifune
au début de sa carrière - trouvent la mort dans les combats
et les duels claniques, dans la boue, la saleté et la trahison,
les plus âgés - Shimura Takashi - dans la maladie et la vieillesse.
La mort, violente ou plus simplement douce est un révélateur,
plus encore, c’est un point où porter le regard, c’est le
moment où, dans une société toute entière portée vers la mort,
l’homme se trouve seul, avec ses appréhensions et ses incertitudes,
et choisit sa liberté. Il rejoint là l’innocence de cet « idiot »,
bien trop candide pour ne pas remettre en cause les attentes
de la communauté, c’est l’événement terrible qui lui accorde
l’affranchissement véritable.
Ce regard, celui de l’idiot et du candide, Kurosawa l’aura
eu toute sa vie durant, on retiendra sa participation au manifeste
des cinéastes japonais en faveur de la réintégration de Langlois
à la Cinémathèque. Il se bat sans faiblir, se sachant faisant
face à des ennemis puissants, ces studios qui font les carrières
et monnayent le talent ; si, à l’instar du personnage de Dostoievski,
« il ne sait rien, ne comprend rien, ni les hommes, ni
les sons, étranger à toute chose » c’est cette innocence
qui lui confère la grâce, et son esprit, et c’est dans la
distance qu’il met entre lui et ses contemporains qu’il obtient
la justesse inégalée de son regard.
|