 |
|
|
|
On ne le dira jamais assez
: ce cinéaste est un génie. Après avoir ri des curetons (Drôle
de paroissien) ; révolutionné le film choral (Y a-t-il
un français dans la salle ?) ; stigmatisé les bourgeois
dans des comédies drôles et grivoises (Les saisons du plaisir)
; bousculé les codes du polar (Agent Trouble), Jean-Pierre
Mocky, dont l’extraordinaire filmographie ne se limite évidemment
pas à ces films, retournait alors à ses furetages dans le
cinéma fantastique. Avec Noir comme le Souvenir, il
livrait une fiction à la fois angoissante et curieuse qui
montrait le parcours tumultueux d’une femme à la recherche
d’une enfant disparue. Cinq ans avant La Secte sans nom
de Jaume Balaguero, Mocky racontait précisément la même
chose sur un mode plus intelligent et subtil. Notons pour
les cinéphiles les plus sourcilleux que Garance, le prénom
de la petite fille blonde dans le film (équivalent de la gamine
dans Poltergeist), est une référence immédiate aux
Enfants du paradis de Marcel Carné qui est le film
préféré de notre provocateur national. Par ailleurs, dans
Noir comme le souvenir, beaucoup de personnages regardent
la télé. Et que regardent-ils ? Litan, l’autre film
fantastique de monsieur Mocky ! Troublante coïncidence, non
?
Autre cinéaste à oeuvrer
dans la bizarrerie hexagonale : Walerian Borowczyk. En 1975,
il signe La Bête, une adaptation fantastique et déjantée
de La Belle et la Bête. L’histoire est loin d’être
simple : pour sauver sa fortune, un marquis décide de marier
son fils un peu niais à la fille d’un ricain cossu. Dès sa
première nuit, la belle fantasme : elle croit voir une aïeule
de son fiancé, poursuivie par une bête monstrueuse munie d’un
sexe gigantesque. D’abord effrayée, la dame finit par prendre
du plaisir jusqu’au jour où la bête meurt… Le réalisateur
des cultes Contes Immoraux, film à sketches délirant
autour du sexe et de la notion de plaisir (réciproque), ose
filmer crûment des scènes de sexe interminables (fellation,
pénétration, éjaculation et consorts) mais bascule aussitôt
dans l’abject et le cradingue. On n’oubliera toutefois pas
de souligner l’audace absolue du projet et les séquences presque
gênantes où la madame se balade nue dans les bois, suivie
par un monstre sensiblement très excité. Effrayant, oui.
LE LOCATAIRE : POINT D’ORGUE
| |
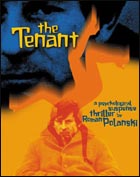 |
|
|
On reste dans les années
70 et l’on succombe - une fois n’est pas coutume - aux délices
du dithyrambe devant ce qui semble être « le film le plus
effrayant au monde » : Le Locataire de Roman Polanski
(1976) ; un authentique cauchemar dans lequel un homme
réservé travaillant dans un service d’archives s’installe
dans un appartement où le voisinage semble particulièrement
étrange. A l’époque, on avait reproché au réalisateur du Pianiste
d’avoir fait avec son Locataire une espèce de transposition
maladroite de son précédent et excellent Répulsion (avec
Catherine Deneuve). Faux : il a fait mille fois mieux ici
en titillant la fibre parano enfouie en chacun de nous et
en suscitant chez le spectateur plein de frayeurs traumatisantes.
Tourné en peu de temps, Le Locataire est un modèle
de sobriété et d’efficacité. Il fait peur avec trois fois
rien, comme ces voisins laconiques qui regardent avec insistance
notre héros. Le dernier plan, d’une redoutable efficacité,
est malin parce qu’il conduit à penser que la folie du personnage
s’est peut-être imprégnée en nous. Que venons-nous de voir
? Et si, nous aussi, nous étions devenus cet homme ? Par extension,
il provoque la claustrophobie en nous faisant comprendre que
cette folle histoire tend à être renouvelée, telle une boucle
jamais finie et que les prochaines victimes sont parmi nous.
|