L'ANGOISSE ET L'ALCHIMIE DES GENRES
| |
 |
|
|
Avant de signer des oeuvres plus accessibles au grand public (Huit
femmes ou même Swimming Pool), François
Ozon s’est illustré dans le film d’horreur. Tout d’abord,
en 1997, avec Regarde la mer, dans lequel une jeune
anglaise passe ses vacances avec sa fille de dix mois sur
l’île d’Yeu dans la maison de son mari qui est resté à Paris.
Elle reçoit, un soir, une routarde qui demande à planter sa
tente dans le jardin… Présenté dans divers festivals, ce moyen-métrage
(52 minutes) fit grincer de nombreuses dents. Le cinéaste
distille l’angoisse par petites gouttes et part d’une situation
somme toute banale pour basculer dans l’horreur la plus terrifiante.
Ceux qui pensent que le cinéaste n’est bon qu’à mettre en
scène des fictions hystériques (Sitcom) et/ou artificielles
(Huit femmes) devraient jeter un oeil sur cet objet
qui s’achève sur une dernière image très dérangeante. L’efficacité
est redoublée par une Marina de Van, plus machiavélique que
jamais… Le genre horrifique ne lâche pas Ozon de sitôt puisqu’il
retente l’expérience en 1999 avec ses Amants Criminels,
conte de fée macabre dans lequel le cinéaste mélange le fait-divers
à la psychanalyse, la féérie à l’horreur et livre une oeuvre
à la fois fascinante et déroutante dans laquelle tous les
interdits sont annihilés et où les perversions sont poussées
à leur paroxysme.
La même année, il faut signaler la présence de deux énergumènes
fantastiques dans la production française : tout d’abord,
Les mille et une merveilles de l’univers de Jean-Michel
Roux, réalisateur à qui l’on doit l’intrigante Enquête
sur le monde invisible, documentaire sur le monde des
elfes d’Islande, qui est plus intéressante que convaincante;
et surtout Serial Lover de James Huth. L’histoire :
Claire, la directrice des "Editions dangereuses",
s'apprête a célébrer ses trente-cinq ans. Tout va bien pour
elle hormis qu'elle est amoureuse de trois hommes aussi brillants,
intelligents et généreux les uns que les autres et qu'elle
aimerait vivre un unique grand amour. Pour les départager,
elle organise un bon dîner qui vire au sanglant… Alors que
dans Serial Mother de John Waters, une mère de famille
assassine tous ceux qui font du mal à sa famille - genre un
petit ami qui met une claque à sa fille - ou qui se comportent
mal - on n’a pas le droit de porter des chaussures blanches
ou de mâcher un chewing-gum en sa présence -, James Huth,
lui, nous montre comment une romancière va assassiner un à
un, involontairement, tous ses beaux prétendants. On n’est
pas au bout de nos surprises avec ce cocktail d’humour et
de macabre absolument réjouissant dans lequel Michèle Laroque
tente de faire face à la présence trop imposante d’Albert
Dupontel (le flic). Le film est tordant du début à la fin
et possède une mise en scène particulièrement brillante. Les
apparitions dans les seconds rôles d’Isabelle Nanty et des
Robins des bois valent à eux-seuls le déplacement.
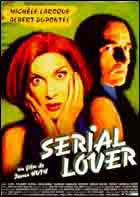 |
|
|
|
Encore plus underground que tous les films suscités : Swamp
d’Eric Bu (1999), authentique curiosité sortie la même année
que Le projet Blair Witch, passe pour la fiction la
moins chère de l’histoire du cinéma. Ce n’en est pas pour
autant la plus rentable. Dans le film, une gamine de treize
ans, condamnée par la maladie, n’a qu’une obsession : tourner
son film d’horreur. Seulement voilà, le tournage ne va pas
se révéler aussi simple que prévu… Malheureusement, malgré
toutes ses belles intentions, le film passe du coq à l’âne
et s’éparpille un peu dans toutes les directions sans parvenir
à maîtriser ce qui aurait dû être une belle «Nuit américaine
du Z». L’argument aurait tenu le temps d’un court-métrage,
mais étalé sur une heure vingt, c’est une purge.
|