UN MARXISTE FASCINE
PAR LE SACRE
| |
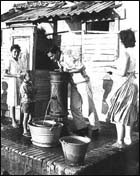 |
|
|
Nous l’avons vu précédemment, l’œuvre
pasolinienne semble reposer sur un dualisme crée par une
exposition double de l’humanité, ainsi que sur un lyrisme
déchiré par « une sorte d’hystérie apocalyptique ».
Mais l’opposition, ou plutôt la contradiction, ne se limite
pas à ces considérations premières. D’une part parce que
ce serait ignorer les convictions politiques et idéologiques
marxistes du cinéaste, constitutives de son cinéma, mais
aussi parce qu’il ne faut pas non plus oublier de traiter
de la relation particulière et complexe que cet athée révolté
a entretenue avec le sacré et le mysticisme religieux. Deux
thèmes prédominants dans l’analyse de l’œuvre pasolinienne
qui lui donnent, en partie, son sens, sa profondeur, et
révèlent une vision particulière et intéressante de deux
idéologies radicalement opposées et contradictoires. D’une
part, Pasolini insère ses œuvres dans un contexte social
déterminé (les classes sous-prolétariennes de la périphérie
romaine) : le cinéaste ancre donc son propos dans une
réalité sociale qu’il ne cessera d’analyser et d’accuser.
En effet, les héros pasoliniens sont tous les proies d’un
système. Davantage politique et social dans les débuts
de son œuvre, comme en témoigne l’environnement urbain et
misérable d’Accatone et de Mama Roma. L’on
sait que Pasolini a violemment critiqué la classe bourgeoise
de l’Italie, notamment dans Théorème, en préférant
la simplicité et la sincérité de la classe prolétarienne.
L’analyse de l’Italie continue dans Comizi d’Amore,
une enquête sur la sexualité où Pasolini arpente les faubourgs
et les plages italiennes afin de déceler les préjugés sociaux
et de les décortiquer en profondeur. Réflexion sur la société
plus que fiction cinématographique, ce document sur la sexualité,
ainsi que les premières œuvres pasoliniennes, reposent sur
une conception marxiste de la société ; soutien du
prolétariat, invective véhémente de la classe bourgeoise
dans laquelle le cinéaste a grandi. Le cinéma pasolinien
s’inscrit en conséquence dans une réalité sociale manifeste.
Et de par ses convictions marxistes, l’on peut se questionner
sur l’attirance et le respect marqué du cinéaste pour la
religion.
Car le sacré dans le cinéma pasolinien est constamment présent,
il habite les œuvres du cinéaste, notamment dans la seconde
période de sa créativité cinématographique. Dans l’Evangile
selon Saint-Matthieu (1964), évidemment, où Pasolini
retrace avec un respect étonnant la vie de Jésus, dans la
Trilogie de la vie, mais aussi dans Salò, où
les ultimes tortures, insupportables, sont élevées à un
degré de sacralité époustouflant et terriblement malsain
(les derniers sévices sont infligés sur des chants religieux).
Hymne à la vie ou liturgie macabre, le sacré englobe l’ensemble
de la pensée pasolinienne, autant d’un point de vue formel
qu’intellectuel. Cependant, il est nécessaire de noter que
le sacré se décline de plusieurs manières dans le cinéma
pasolinien : Dans sa dimension chrétienne, le sacré
chez Pasolini mêle l’attitude respectueuse (L’Evangile)
et une désapprobation manifeste, comme en témoigne Théorème,
où la figure divine n’est pas un révélateur spirituel, mais
sexuel. La contradiction est une fois de plus visible.