Le cinéaste Samuel Fuller a trouvé
sa place dans le film américain d’un metteur en scène allemand
qui est plein d’allusions intertextuelles. Les références
sont plus que directes. Il n’est pas surprenant que le fils
du personnage joué par Fuller s’appelle Ray et ce n’est pas
un hasard non plus qu’il travaille dans l’observatoire situé
dans le Griffith Park.
Tout comme Nicholas Ray, Samuel Fuller est une des idoles
de Wenders, un père spirituel venu de Hollywood, ce lieu qui
représente à la fois le père et la mère du cinéma. Mais quand
Ray Bering/Gabriel Byrne contemple Los Angeles de la hauteur
des collines qui bordent la Cité des Anges, celle-ci, cachée
sous la brume, se dérobe à son regard.
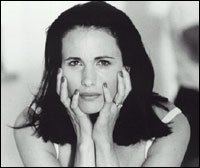 |
|
|
|
On pourrait longuement spéculer sur
les relations entre Wenders, Fuller et le cinéma américain.
On pourrait se demander si Ray Bering est un substitut pour
le metteur en scène allemand. Les séquences dans lesquelles
apparaît Fuller sont des espaces-temps constituants des réflexions
filmiques qu’ils engendrent en créant des relations intertextuelles.
Une gamme très riche de réflexions est explorée à travers
les relations entre les personnages et les portraits très
fins et très nuancés des personnages. Présentés de façon économe
mais extrêmement précise, les caractères humains font tout
simplement entrevoir les possibilités des relations entre
les hommes. Ils sont l’expression de l’existence et celle
de la vie tout court.
Le père, un vieillard parfois têtu qui refuse de renoncer
à sa machine à écrire qui lui est devenue familière et qui
ignore le téléphone. Le fils, un informaticien très doué qui
travaille avec une technologie des plus modernes mais qui
ne possède pas de permis de conduire. Tous les deux se rencontrent
dans leur tentative opiniâtre de vouloir conserver leur individualité.
Et dans le désir douloureux, peut-être réprimé, pour l’amour
et pour l’affection.
| |
 |
|
|
La violence est un sujet des films
du metteur en scène Fuller et un élément-clef de maintes
de ses oeuvres qui rendent la brutalité transparente. Pour
Wenders, la violence en tant que motif narratif et esthétique
devient un instrument de mise en question. Sous l’effet
des balles, le corps de Ray Bering est carrément projeté
dans l’espace. Sa mort violente crée un véritable choc.
Dans les plans qui succèdent à son assassinat, on voit Louis
Bering seul dans sa chambre à peine éclairée. Pressentant
la perte (?), son corps est secoué de larmes. La douleur
et le deuil marquent ce moment d’une tristesse infinie qui
inonde les images, envahit l’espace et touche violemment
le spectateur.