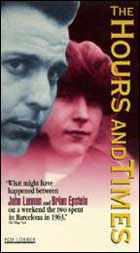 |
|
|
|
Commençons par la sélection américaine.
Ce genre de festival offre l’occasion de réviser des positions
trop dogmatiques sur l’hégémonie du cinéma américain. Ici,
les films américains, forcément indépendants, sont comme les
autres : fragiles, précaires, humains, marqués par leur identité
et leur ancrage local. Le cinéma américain désigne moins un
pays qu’un système industriel transnational et capitaliste
correspondant assez bien au concept d’Empire » forgé par Tonio
Negri. Un système qui peut écraser les films américains eux-mêmes.
Cela étant, rien de grandiose dans la sélection américaine,
si ce n’est les films de Christopher Munch, cinéaste talentueux
jamais distribué en France, qui était présent aux Rencontres.
Son premier film, The hours and times, est un petit
bijou d’intelligence, de raffinement et d’humour. L’histoire
s‘inspire du séjour de quatre jours passés à Barcelone en
1963 par John Lennon et Brian Epstein, le manager des Beatles.
Munch imagine de toutes pièces ce qui a pu se passer entre
les deux hommes. En l’occurrence un échange savoureux entre
deux hommes que tout oppose : Epstein le juif, distingué,
homo, tourmenté, évidemment amoureux de Lennon, et ce dernier,
le bon anglais prolo hétéro, aux manières rudes et directes.
Munch évite le théâtre filmé grâce à une mise en scène inventive
et dynamique, tout en laissant la part belle à des dialogues
très écrits et ciselés. D’emblée, avec ce premier film, Munch
révèle un goût de l’intelligence et du brio, et semble marqué
par une certaine culture et sensibilité européenne. Je n’ai
pas vu son deuxième film, The color of a brisk and leaping
day mais son troisième et dernier, The sleep time gal
avec Jacqueline Bisset a confirmé la bonne impression du premier.
À partir d’un matériau autobiographique, la femme atteinte
d’un cancer que joue Bisset étant inspirée par la mère du
réalisateur, Munch transcende cette matière brute et évite
l’impudeur grâce à une structure narrative savamment élaborée
et complexe, qui rappelle plus la littérature que la moulinette
hollywoodienne, et un montage très fluide. En effet, l’auteur
mêle les strates temporelles et les points de vue narratifs
; deux histoires finissent par converger : il y a d’une part,
Frances, femme d’une cinquantaine d’années atteinte d’un cancer,
autour de qui gravitent d’autres personnages, son fils, un
amour de jeunesse ; d’autre part, il y a Rebecca, jeune
avocate orpheline à la recherche de ses origines. Grâce à
la qualité de la mise en scène et une certaine délicatesse,
le film atteint une réelle force d’émotion, sans forcer le
ton.
L’autre film américain que j’ai vu, The American Saint,
est une œuvrette insignifiante et sans surprise. L’histoire
d’un jeune serveur new-yorkais en quête de gloire qui traverse
les Etats-Unis en voiture avec un vieux chauffeur de taxi
pour passer une audition à Los Angeles pour le rôle de Jack
Kerouak dans le prochain film de Milos Forman. L’intérêt principal
était de retrouver l’acteur à gueule mémorable, Vincent Schiavelli,
invité permanent des Rencontres et dont on pouvait croiser
dans les couloirs la silhouette dégingandée. Sinon, tourné
en DV, The Americain Saint n’est qu’un road movie
de plus, vu et revu, qui reprend paresseusement tous les codes
du genre (on pense notamment à L’épouvantail), qui
plus est doté d’une fin bien mièvre, se voulant un hommage
à l’esprit de rébellion de Kerouac.
|