HAMMER
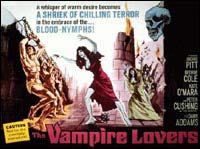 |
|
|
|
La rétrospective
Hammer constitua peut-être le véritable événement
de cette 13e édition, puisqu’elle s ‘accompagnait
de la venue de quelques grands noms du cinéma fantastique
anglais : le scénariste Jimmy Sangster, Freddy Francis
qu’on ne présente plus, Ray Harryhausen, et les actrices
Caroline Munro, Ingrid Pitt, et Valerie Leon.
N’ayant pu assister aux projections que ces mythiques invités
présentaient, je ne saurais dire quel accueil ils reçurent
face à leur (très jeune) public ; mais
les cinq jours du festival ne leur auraient sans doute pas
suffi pour évoquer la diversité de leur expériences.
" L’hommage à la Hammer " restreignit
sa programmation à la période gothique, en montrant
des films déjà programmés au Centre Pompidou
l’an dernier, dans le cadre du panorama du cinéma anglais.
Furent donc présentés les classiques de la firme
défunte (Le Cauchemar de Dracula, La Nuit du Loup
Garou, et les deux films intermédiaires de la série
consacré à Frankenstein, La Revanche de Frankenstein
et le Retour de Frankenstein) , mais également
des films mineurs (réalisés tous deux par Roy
Ward Baker) , plus représentatifs de l’évolution
des " ingrédients " de la firme
que les chefs d’œuvre de Fisher.
| |
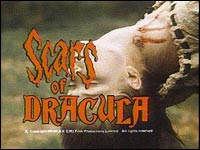 |
|
|
Scars of Dracula
(1970) se distingue ainsi par sa violence outrancière,
parfois sadique, et le retour du personnage du Prince des
Ténèbres à une plus grande bestialité,
après l’érotisation introduite par Terence Fisher.
The Vampire Lovers (1970), est une curiosité :
adapté de la " Carmilla " de Sheridan
le Fanu, le film se concentre sur la relation lesbienne qui
s’installe entre une femme-vampire et ses jeunes victimes.
Tout cela reste bien prude, la caméra préférant
s’attarder sur de bien ennuyeuses séquences de bain,
et autres frous frous dénudés. A deux reprises
cependant, un personnage masculin est mis en danger, et l’ambivalence
de la femme-vampire, à la fois séductrice et
castratrice, transparaît notamment dans une séquence
d’ouverture inoubliable.
La présentation quasi exhaustive des films gothiques
de Terence Fisher rappela l’évidente supériorité
de cet artiste de la mélancolie sur les artisans honnêtes
que furent Roy Ward Baker, Freddie Francis ou John Gilling.
Revoir La Gorgone convoqua aussitôt un autre
grand nom du fantastique, Jacques Tourneur : avec ce
beau personnage de femme (interprétée par la
plus belle actrice du fantastique anglais, Barbara Shelley)
devenant la mythique gorgone lorsque la nuit vient, la femme
aimée stupéfie ; l’unique moyen de l’affronter
est alors de médiatiser son image, grâce à
un miroir, ou plus évocateur encore, en regardant son
reflet trouble et intermittent dans le bac d’une fontaine.
LONG METRAGES VUS A VALENCIENNES
 |
|
|
|
Taking
Sides de Iszvan Szabò
(Allemagne, France, Hongrie 2001, sortie le 17 avril 2002)
Le " cas Furtwangler "
(l’historique) pose la question de la responsabilité
de l’artiste face à la dictature ; Furtwangler,
chef d’orcheste célèbre ayant choisi de rester
en Allemagne nazie, en constitue peut-être l’exemple
idéal.
Ce noble sujet est donc
le prétexte à un procès en huis clos,
où un officier américain rugueux cherche à
prouver la culpabilité morale du musicien.
Malgré une mise en
scène inégale, entre théâtre filmé
et séquences cherchant la majesté, parfaitement
ridicules (Furtwangler, restant nu tête, le regard fiévreux,
sous la pluie dans un concert en plein air, tandis que tous
ouvrent leur parapluie…), le film de Szabò, déjà
chroniqueur de l’époque nazie dans Mephisto,
parvient à étonner, et même à interroger
son statut de " film à thèse "
moralisateur : certes, le discours scénaristique accuse
Furtwangler et légitime la rigueur morale de l’officier
américain (Harvey Keitel en sosie balourd de Clark
Gable) . Mais la légitimité du film comme
" œuvre " s’effondre alors, puisque l’œuvre
d’art ne pèse rien dans les affaires de ce monde (selon
le film bien entendu).
" S'il ne
reste que le matériel, il ne reste que de la fange "
dit Furtwangler-Skarksgard au cours de son interrogatoire :
dans quelques rares moments, le film parvient à toucher
au réel, en décrivant le conformisme matérialiste
de l’américain et sa frustration sexuelle, ou en intégrant
des images hétérogènes à son esthétique
léchée : vues des camps de concentration,
et propagande américaine, paranoïaque et inquiétante.
|