| COMPETITION FICTION :
BUDGET OR " NO-BUDGET "
La fiction, à laquelle
on réduit bien souvent le court-métrage, était
un peu le parent pauvre - en termes de qualité - des
films présentés à cette édition
2002. La sélection ne privilégiait pas une durée
particulière (5’ pour Paris 2000, Année du
Dragon à 28’ pour Maloriage) dans un festival
consacré exclusivement aux supports vidéo et
numérique. La présence de films étrangers,
suédois, danois et polonais notamment, était
en tout cas un signe encourageant de l’intérêt
porté au festival par le milieu de la production de
court-métrage européen. Y aurait-il une porte
dérobée reliant le nord de la France au nord
de l’Europe ?
| |
 |
|
|
La catégorisation
des films dans deux sections (fiction et fiction " no-budget "),
fondée davantage sur l’économique que sur l’esthétique,
ne se justifiait pourtant pas, et entraînait le risque
d’une confusion entre " no-budget " et
" no-talent ". Cependant, malgré
ces ambiguïtés conceptuelles, le délicat
équilibre tonal que se doit d’atteindre la programmation
de courts-métrages était réussi, avec
un intérêt marqué pour le fantastique
sous toutes ces formes. Nombre de films montraient ainsi la
volonté de saisir des instants d’intensité réceptive
propices au mélange de plusieurs niveaux de réalité.
Il ne s’agissait pas tant d’onirisme, que d’une attention
portée aux instants de relâchement, où
l’esprit vagabonde. Ces états semi-éveillés
se retrouvaient dans la plupart des films sur le monde du
travail, comme une alternative à la description plus
classique de l’état amoureux. En filigrane, pointait
donc une critique un peu résignée (la rêverie
plutôt que l’action) d’une réalité jugée
frustrante.
D’autre part, la sélection
se caractérisait par une attention particulière
aux pratiques contemporaines de l’appropriation et de l’hybridation :
que ce soit dans l’inscription et ou le détournement
d’un genre (6 Wenesdays de Christian Dyekjar, Maloriage,
Antoine Moreau), le mélange de régimes d’images
(Teflon, de Berry Nathan), ou plus simplement la parodie
(Ruelle de Yan d’Annoville et Christophe Gaillard).
De ce fait, les fictions plus classiques, travaillant respectueusement
à l’intérieur d’un genre (Effraction,
de Patrick Halpine) étaient minoritaires. Ce qui n'a
pas empéché Azyl Killer, polar urbain
sous influence, de décrocher le prix " No-Budget ".
Au petit jeu des influences revendiquées par les cinéastes
de court-métrages, se détachait la figure artistique
de David Lynch, chantre de l’exploration d’une perception
alternative de la réalité.
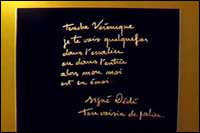 |
|
|
|
Le Grand Prix, décerné
à Lettres à ma Voisine de Thierry Gracia,
était pour le moins contestable, en récompensant
un film à la chute amusante, mais sans autre intérêt
que formel. Un court-métrage " classique "
donc, dans une forme proche des jeux de collages de Jeunet
et Caro. Cependant, le choix du jury, présidé
par Rémy Julienne, avalisait la démarche des
sélectionneurs de privilégier une fiction ouverte
sur l’expérimentation formelle.
Les prix " No-Budget ",
Azyl Killer (ou : je veux seulement filmer l’amour)
des frères Igosta et Pas Trop Près de
Murielle Iris (film que je n’ai personnellement pas compris),
récompensaient les films les plus aboutis cinématographiquement
de cette catégorie.
Six Mercredi, de Christian Dyekjar, Danemark
À deux doigts de
gagner le Grand Prix (il obtint la " mention du
jury "), 6 Wenesdays est un western revisité,
à la nonchalance héritée de Rio Bravo.
Un moniteur d’auto-école nouvellement arrivé
en ville, lutte pour assurer son gagne-pain face aux manœuvres
sordides de son concurrent, tout en cherchant à gagner
l’amour de la " prostituée locale ".
Le tout décrit en 6 jours, 6 mercredis successifs,
comme autant d’instantanées d’un système à
trois ordonnées (la voiture, Mona la prostituée,
la menace de la réputation). Le rapport ambigu qu’entretient
le film à la prostitution se satisfait cependant des
trop nombreuses ellipses du personnage de Mona, et malgré
l’élégance de sa mise en scène, 6
Wenesdays a des relents machistes assez détestables.
|